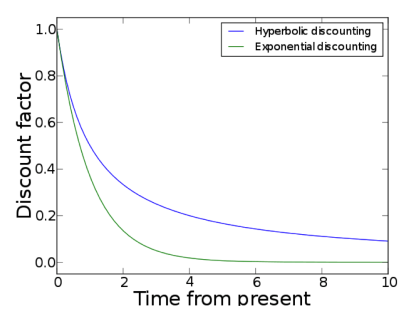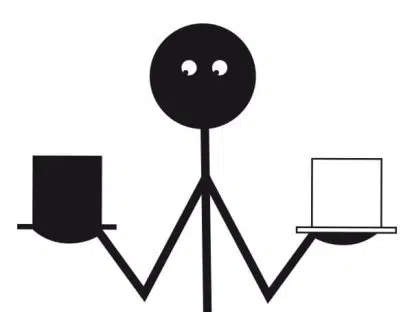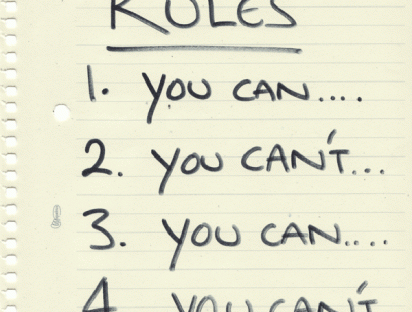L’un des arguments en faveur d’une utilisation plus large de l’anglais dans l’enseignement supérieur en France peut être appelé « argument de la langue de relation ». Il répond à l’« argument de la marchandisation » selon lequel l’extension de l’anglais dans beaucoup de domaines de la vie humaine (pas seulement le commerce et l’enseignement), et en dehors de sa zone géographique d’origine, s’accompagne d’une uniformisation culturelle qui serait fondée sur une espèce de « sous-culture américaine », pour reprendre l’expression récemment employée par Claude Hagège dans sa tribune publiée dans Le Monde du 26 avril 2013 (« Refusons le sabordage du français »). L’argument de la langue de relation affirme que si la variété d’anglais dont l’extension est discutée, voire dénoncée, est effectivement une langue de relation (un anglais lingua franca), et qu’une telle langue est déconnectée de toute culture ou dénuée de fondement culturel, alors la variété d’anglais en question n’est pas un vecteur d’uniformisation culturelle. Mais pour être convaincant, l’argument doit prouver que cette hypothèse est valide, ce qui est un exercice plutôt délicat.
L’argument de la langue de relation comprend plusieurs étapes. Il consiste d’abord à affirmer que le système linguistique en cause est une langue de relation ou de liaison, non une langue naturelle possédant la richesse culturelle de toute langue naturelle. La langue anglaise (il conviendrait ici d’en distinguer plusieurs sous-familles linguistiques) est intimement liée à une culture – elle exprime en particulier des significations et des symboles que seuls les représentants de la culture en question sont susceptibles de comprendre. Une langue de relation a une fonction purement technique, sans rapport avec quelque culture que ce soit. Les significations et les symboles qu’elle véhicule font référence à des conventions aisément compréhensibles par des personnes de cultures différentes. Les mots qui la composent sont univoques au sens où ils ne donnent lieu qu’à une seule interprétation. La simplicité (ou la pauvreté) de ses significations implique qu’elle n’est pas elle-même porteuse d’une culture unique. En conséquence, si, par exemple, un enseignement est dispensé, au sein d’un établissement français, dans l’anglais lingua franca, il ne véhicule aucun trait culturel particulier. Donc l’argument de la marchandisation (comme celui de l’identité, cf. « Les arguments sur la place de la langue française dans l’enseignement supérieur .1. ») ne tient pas.
On notera que l’argument de la langue de relation est à première vue compatible avec la proposition de loi sénatoriale relative à l’attractivité universitaire de la France, même si elle ne fait pas allusion à l’anglais lingua franca. Car celle-ci souligne d’une part que, « par dérogation à l’article L. 121-3, la langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires, dans les établissements d’enseignement supérieur, peut être une autre langue que le français » – c’est-à-dire qu’elle ne fait pas référence à la culture que cette « autre langue » véhicule. Cependant, l’affirmation suivante, qui traite de l’enseignement du français, le relie à la culture : « Pour les étudiants ne justifiant pas d’une connaissance suffisante du français, lorsqu’ils suivent une formation dispensée dans une langue étrangère, cette dérogation est soumise à l’obligation de suivre un cursus d’apprentissage de la langue et de la culture françaises ».
Quelle est la valeur de l’« argument de la langue de relation » ? (a) On peut d’abord mettre en doute l’idée selon laquelle l’anglais comme langue de l’enseignement supérieur soit une langue véhiculaire, de relation ou de liaison. Dans un article paru en 2009, la linguiste et spécialiste de l’anglais Josiane Hay reprend les définitions de ces notions, précisant que la lingua franca est « dans son sens contemporain, (…) « a common language », « une langue auxiliaire de relation » (1). Elle ajoute que « la langue est véhiculaire, lingua franca ou auxiliaire lorsqu’elle assume une fonction de truchement, de liaison, d’aide à la communication ». Cependant il est peu probable que cette « nouvelle langue commune », « langue de liaison entre les cultures du monde », soit celle que parlent tous les professeurs qui emploient et emploieront l’anglais dans le cadre de leur enseignement en France, ne serait-ce que parce que certains d’entre eux ont une maîtrise approfondie de l’anglais (Eric Orsenna affirmait cependant, dans Les Matins de France Culture du 26 avril 2013, que la mesure prévue par le projet de loi Fioraso « est grotesque : pourquoi des Coréens viendraient-ils chez nous écouter des profs français qui parlent mal anglais, au lieu d’aller dans les pays de langue anglaise ? »).
(b) Une deuxième objection à l’argument de la langue de relation est que, même si l’anglais enseigné est une langue pauvre, remplissant une simple fonction de liaison, elle contient des éléments culturels. Josiane Hay affirme elle-même qu’aucune langue de relation n’est vraiment neutre, ne serait-ce que parce qu’elle véhicule les pratiques qu’elle rend possible, en particulier les pratiques commerciales : « L’ensemble des langues véhiculaires, lingua franca et langues auxiliaires recouvre, nous le savons, un large éventail d’usages, du plus rudimentaire au plus sophistiqué. Néanmoins, on a pu voir que ces langues ont toutes en commun de ne pas être porteuses de culture au sens plein des langues naturelles. Elles se tiennent culturellement en retrait et tentent d’être des intermédiaires, des médiateurs neutres ou, devrait-on dire, aussi neutre que possible, parce qu’aucune langue, serait-elle véhiculaire ou auxiliaire, ne peut être totalement neutre. Toutes les langues sont chargées de l’histoire des peuples qui les ont parlées et les langues véhiculaires et auxiliaires, en contact constant avec d’autres langues, sont encore plus fortement tributaires de l’image de leur passé et de son influence sur la perception des locuteurs d’autres langues. Pourtant, si ces langues ne sont pas pleinement porteuses de leur culture d’origine, l’histoire montre qu’elles sont porteuses d’une vision d’un monde fait d’échanges commerciaux, philosophiques, littéraires, scientifiques, un monde de circulation des idées, ouvert sur les autres cultures – les grands textes philosophiques grecs, dont les originaux se sont parfois perdus, ont pu circuler à travers l’Europe grâce à des langues auxiliaires. »
(c) On peut ajouter à la remarque de Josiane Hay un autre argument, plus cognitif. Il repose sur l’impossibilité de traduire de façon parfaitement fidèle un texte d’une langue dans une autre, en raison des différences des réseaux de significations et de symboles qui sont particuliers à chaque langue naturelle. Il est seulement possible, comme le soulignait le spécialiste de sciences cognitives Douglas Hofstadter, « d’obtenir une certaine équivalence approximative » (2).
L’un de ses exemples vaut la peine d’être cité. Hofstadter choisit le poème « Jabberwocky » de Lewis Carroll, spécialement son avant-dernière strophe : « “And has thou slain the Jabberwock? / Come to my arms, my beamish boy! / O frabjous day! Calloh! Callay!” / He chortled in his joy », dont l’une des traductions françaises est : « « Tu as donc tué le Jabberwock ! / Dans mes bras, mon fils rayonnois ! / O jour frabieux! Callouh! Callock ! » / Le vieux glouffait de joie. » (3)
Hofstadter se demande comment traduire le verbe « to chortle » en français (une invention de Carroll à partir des verbes « to chuckle » et « to snort ») ? Il répond que, « dans le cerveau d’un anglophone, le mot « chortled » […] aura tendance à activer les symboles « chuckled » [to chuckle : glousser] et « snorted » [to snort : grogner]. Le verbe « glouffait » excite-t-il les symboles correspondants dans le cerveau d’un francophone ? D’ailleurs, comment définir ce que devrait être l’« effet correspondant » ? Serait-ce l’excitation des symboles qui sont les traductions ordinaires de ces mots ? Et s’il n’existait pas de tel mot, ni réel ni inventé ? Ou s’il existe, mais faisait nettement religieux et latin (par exemple « jubultait ») et non pas courant et anglo-saxon (« chortled ») ? Tout compte fait, « jubultait » serait peut-être meilleur que « glouffait » ? Son origine latine ne produirait sans doute pas le même effet sur un francophone qu’un terme anglais comme « jubulted » sur un anglophone. » Il conclut que « face à un tel exemple, on se rend compte qu’il est absolument impossible de traduire exactement un texte. Il semble néanmoins possible, même dans un cas aussi insolite que le « Jabberwocky », d’obtenir une certaine équivalence approximative ».
L’idée qu’il est possible « d’obtenir une certaine équivalence approximative » donne du crédit à la thèse selon laquelle même une langue de relation, comme l’anglais lingua franca, peut éveiller des significations et des symboles entre des locuteurs de langues différentes. Tout dépend cependant des contextes dans lesquels la lingua franca est utilisée. Dans le contexte des affaires (y compris dans celui de l’enseignement de gestion), l’usage intensif de l’anglais peut tendre à créer des noyaux de significations relatifs aux pratiques commerciales. Dans un article récemment paru dans le Journal of Business Ethics, plusieurs auteurs se demandaient comment l’expression « stakeholder management », souvent invoquée par les théoriciens et les praticiens, était comprise par des locuteurs de différentes nationalités selon les traductions locales, notamment française (gestion des parties prenantes), italienne (portatori di interessi), norvégienne (fokus på interessegrupper) et espagnole (grupos de interes) (4). Un effort qui témoigne du souci de mesurer les écarts de sens pour un concept donné, ainsi que la distance relative, selon les langues, entre des concepts largement utilisés dans l’anglais lingua franca (par exemple la distance conceptuelle entre la « gestion des parties prenantes » et le « développement durable »). Mais un effort qui a aussi pour but de contribuer à une « certaine équivalence approximative » des mots de l’anglais lingua franca propre au management – et, en même temps, on peut le supposer, à leur conférer une valeur symbolique et culturelle. Une telle lingua franca – la « langue du management » – deviendrait analogue à une langue naturelle. Si tel était le cas, ceci plaiderait en défaveur de l’« argument de la langue de relation » – et certainement en faveur de l’« argument de la marchandisation ».
Alain Anquetil
(1) J. Hay, « Interculturel et langues véhiculaires et auxiliaires : réflexion sur l’anglais lingua franca », Cahiers de l’APLIUT [En ligne], 28(1), 2009, mis en ligne le 23 février 2012, p. 63-76.
(2) D. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: An eternal golden braid, 1979, Basic Books, 20th Aniversary Edition,1999 ; tr. fr. J. Henry et R. French, Gödel, Escher, Bach: les brins d’une guirlande éternelle, Paris, Dunod, 1985, 2000.
(3) Lewis Caroll (1871), Through the Looking-Glass and What Alice Found There, 1872.
(4) H.-J. Schlierer, A. Werner, S. Signori, E. Garriga, H. von Weltzien Hoivik, A. Van Rossem et Y. Fassin, « How do european SME owner–managers make sense of ‘stakeholder management’? Insights from a cross-national study », Journal of Business Ethics, 109, 2012, p. 39-51.
Image à la une : Illustration du Jabberwocky par John Tenniel - Domaine Public - via wikipedia