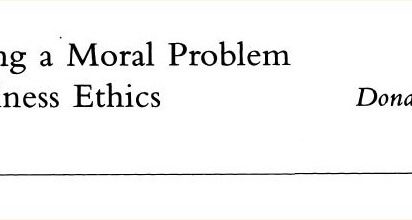Le besoin de contrôle se manifeste dans beaucoup de domaines de la vie humaine. Récemment, il a été mis en avant à propos de l’accord d’échange automatique d’informations sur les données fiscales, signé fin octobre 2014 sous l’égide du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (cf. l’article du Monde « Opération transparence sur la fiscalité mondiale »). On le trouvait aussi associé à l’idée de « frontière » que Sabine Dullin analyse dans son ouvrage La frontière épaisse. Aux origines des politiques soviétiques (1920-1940), paru le mois dernier. Et il était le thème de l’interview d’Isabelle Veyrat-Masson relative au besoin de contrôle des dirigeants de grandes entreprises, diffusée sur France Culture le 25 octobre 2014. Rien d’étonnant à ce qu’on le trouve invoqué dans l’éthique des affaires académique. J’en propose deux exemples. Le premier consiste en un rejet de l’esprit de contrôle qui serait caractéristique d’une certaine vision des organisations. Le prochain billet sera l’occasion de discuter de la relation entre compliance et contrôle.
Dans une interview sur la place du secret au sein des entreprises, Isabelle Veyrat-Masson, directrice de recherche au CNRS, indique que « le secret fait partie de la vie des entreprises », que « le contrôle sur les moyens de l’information est nécessaire », qu’il « apparaît comme une évidence pour les gens qui ont l’habitude de commander, qui ont l’argent, qui ont le pouvoir », que les dirigeants « ont des moyens considérables pour cela, en particulier acheter des entreprises », notamment des entreprises de média, « pour contrôler l’information », « payer des communicants, des lobbyistes , (…) jouer sur les investissements publicitaires », enfin, ajoute Isabelle Veyrat-Masson, que la corruption peut faire partie des moyens de contrôle (« on paie les médias, on paie les journalistes, pour faire passer des informations qui vont, soit faire monter le cours de bourse, soit le faire baisser quand il s’agit de concurrents »).
L’idée que le contrôle « apparaît comme une évidence » mérite réflexion. Elle semble se référer à la notion de « besoin de contrôle », qui a été étudiée au sein de la psychologie sociale.
Éric Dépret souligne que le besoin de contrôle renvoie à « l’action de maîtriser l’environnement » (1). Ainsi, « avoir du contrôle sur un événement de l’environnement (…), c’est disposer d’une réponse comportementale qui modifie la probabilité d’occurrence de l’événement dans le sens désiré par l’acteur ». Et « exercer le contrôle, c’est émettre effectivement une telle réponse comportementale ».
Dépret remarque que l’exercice du contrôle paraît être le moyen d’atteindre d’autres buts – par exemple la maîtrise de l’image d’une entreprise à laquelle faisait référence Veyrat-Masson. Mais certains psychologues estiment que le besoin de contrôle peut être une fin en soi, qu’il peut ne pas être au service d’une autre fin que lui-même. Par exemple, ce besoin autonome de contrôle expliquerait « l’activité exploratoire, ludique, de l’enfant, et le plaisir qu’il éprouve à produire des effets et accroître se maîtrise de l’environnement », cette activité engendrant à son tour « un sentiment de maîtrise, de puissance, de compétence ».
Le plaisir d’exercer le contrôle semble se confondre avec le plaisir de l’exercice du pouvoir. Il faut dire que le sens du mot « contrôle » n’est pas ici celui de la vérification du respect d’une règle – le sens d’une « vérification portant sur des choses en vue d’examiner si elles remplissent les conditions demandées » – mais celui de « la maîtrise, la direction et l’administration des choses et des gens », qui le rapproche de l’exercice du pouvoir (2). C’est ce sens qui est repris dans un article ambitieux paru en 1994 dans la revue Business Ethics Quarterly. Andrew Wicks, Daniel Gilbert et Edward Freeman y proposaient de dénoncer et de réduire l’appel à l’idée de « contrôle » lorsque l’on décrit le monde des affaires. Car cette idée fait partie, selon eux, des « images et de structures clairement masculines qui opèrent dans notre environnement quotidien », qui contribuent à le décrire, à le définir, à « façonner nos pensées au sujet de l’entreprise et du concept de partie prenante » (3). Cette métaphore du contrôle, ils la désignent par la proposition suivante : « Les entreprises sont censées commander et contrôler leur environnement ».
Pourquoi, selon cette métaphore, les entreprises devraient-elles s’efforcer de maîtriser leur environnement ? L’explication donnée par les auteurs, d’ordre général, rejoint les considérations de Dépret sur le besoin de contrôle : « la prémisse est ici que, dans un monde caractérisé par la complexité et le changement, les individus ont besoin d’ordre et de stabilité pour que leurs besoins élémentaires soient satisfaits ». L’environnement fait peur, il est source d’incertitude et de désordre. Or, les organisations, atomes isolés dans un monde de compétition, s’efforcent, comme le mot « organisation » l’indique, d’ordonner leurs actions, de les planifier, de les mettre en œuvre, de les coordonner, d’évaluer leurs effets, de les corriger avant d’en planifier de nouvelles. Qu’il soit un individu ou un groupe humain, un agent confronté à un tel environnement a pour « réaction naturelle », selon les auteurs, « de chercher à prendre le contrôle, de conquérir ce qui est autre ou ce qui perturbe, de dominer pour restaurer l’ordre ». Wicks, Gilbert et Freeman vont au-delà de l’idée que cette réaction a un caractère plutôt masculin, ils la retrouvent aussi « chez Platon dans sa recherche des Formes composant l’essence simple et harmonieuse de la réalité, Formes qui sont occultées par les illusions et les complexités trompeuses de nos perceptions sensibles ».
De ce besoin naturel de contrôle naît la croyance, partagée par les acteurs du monde économique, que « le fait de ne pas réussir à exercer le contrôle se traduira très probablement par des pertes d’opportunités, par des conditions de marché peu favorables, par des restrictions gouvernementales, par la menace d’une baisse de profits due aux consommateurs hostiles et aux syndicats qui, par leurs actions cumulées, ont la possibilité de mettre en danger la survie même de l’entreprise ». Pour Wicks, Gilbert et Freeman, c’est cette croyance-là qu’il convient avant tout de débusquer et de remplacer par une vision mieux fondée du rapport que devrait entretenir une firme avec le monde extérieur. Cette vision consiste, pour une firme, à « créer des relations harmonieuses avec son environnement, [à] s’en occuper et [à] le préserver avec autant de soin que celui qu’on accorde à sa propre personne, plutôt [qu’à] essayer de le conquérir et de le contrôler ». Une entreprise est un système de coopération, mais cette coopération ne doit pas avoir pour objectif de remédier aux supposées menaces de l’environnement : elle doit s’y adapter et se construire avec lui.
En dépit de leur effort d’explicitation et de leur tentative de proposer un nouveau mode de description de la vie économique, les auteurs n’exploitent pas l’idée que le besoin de contrôle dont ils dénoncent l’importance pourrait être une fin en soi, et non uniquement un moyen parmi d’autres d’assurer la prospérité d’une organisation. C’est d’autant plus regrettable que les auteurs s’efforçaient (à juste titre) de développer une approche naturaliste de la place des organisations dans leur environnement.
Alain Anquetil
(1) É. Dépret, « Besoin de contrôle, sentiment de contrôle et concept de soi », in J.-C. Deschamps et J.-L. Beauvois, Des attitudes aux attributions. ur la construction de la réalité sociale (T. II), Presses universitaires de Grenoble, 1996.
(2) C. Godin, Dictionnaire de philosophie, Fayard, 2004.
(3) A.C. Wicks, D.R. Gilbert et R.E. Freeman, « A feminist reinterpretation of the stakeholder concept », Business Ethics Quarterly, 4(4), p. 475-497, 1994 ; tr. fr. Laugier C., « Une réinterprétation féministe du concept de partie prenante », in Anquetil A. (dir.), Textes clés de l’éthique des affaires, Vrin, 2011.