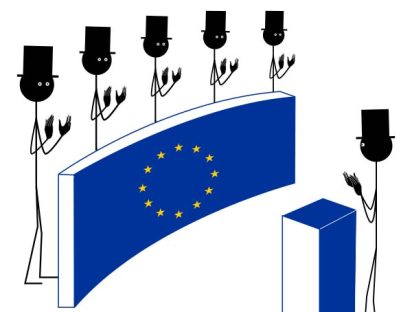Le 13 octobre 2011, Michael Woodford, quelques mois après sa nomination comme directeur général d’Olympus, était démis de ses fonctions par le conseil d’administration. La raison annoncée résidait dans sa « méthode de travail inappropriée » (Libération du 3 janvier 2012). D’après les propos du président d’Olympus, Tsuyoshi Kikukawa, la « méthode » de Woodford révélait une incompatibilité culturelle entre des habitudes managériales typiques de la culture occidentale et les normes propres à la culture japonaise dont Olympus est un représentant (New York Times du 8 novembre 2011).
Toutefois cette raison a été très vite reléguée au second rang, voire considérée comme un prétexte commode. Car la raison principale de l’éviction du directeur général résidait, selon Woodford lui-même, dans le fait qu’il s’apprêtait à révéler que des fraudes financières avaient probablement été commises par d’anciens dirigeants d’Olympus. Issues d’un rapport qu’il avait demandé au cabinet PricewaterhouseCoopers, ces suspicions portaient sur trois acquisitions réalisées par Olympus entre 2006 et 2008. Elles avaient peu de rapports avec le cœur de métier de l’entreprise et la valeur des titres avait fait l’objet d’une importante dépréciation comptable dès la première année, révélant un prix d’acquisition très élevé ou une bien mauvaise affaire. Les suspicions portaient aussi sur des honoraires substantiels versés par Olympus à deux intermédiaires financiers lors de l’acquisition en 2008 de Gyrus, fabricant britannique de matériel médical. Les honoraires représentaient un tiers du montant de la vente alors qu’habituellement ils ne dépassent pas 2%.
Beaucoup de commentaires ont été écrits sur ces présomptions de fraudes comptables et sur leurs conséquences – la conséquence la plus spectaculaire ayant été la baisse significative du cours d’Olympus à la bourse de Tokyo et le risque de radiation de la cote, qui a été évité de justesse mi-décembre 2011. La démission de trois hauts dirigeants (dont le président Kikukawa) et le possible retour de Woodford à la tête de l’entreprise ont aussi été amplement discutés.
Finalement, Woodford ne reprendra pas la direction d’Olympus. Il n’a pas réussi à obtenir le soutien des investisseurs et créanciers japonais de l’entreprise. Point intéressant, un article du New York Times du 6 janvier 2012 interprète cet échec en termes culturels : « La réticence perceptible du régulateur financier dans son traitement du scandale et le soutien tacite et amical des banques et des actionnaires institutionnels japonais ont renforcé, chez les investisseurs étrangers, l’idée que les dirigeants d’entreprise qui sont en place au Japon peuvent, aujourd’hui encore, s’opposer à toute initiative de changement ».
Ce commentaire redonne singulièrement du poids à l’argument de l’incompatibilité culturelle qui avait été avancé à l’origine pour justifier le limogeage de Woodford le 13 octobre, puis éclipsé. Plus que le résultat d’une incompréhension d’ordre culturel, le cas de Woodford avait fini par être interprété comme un cas particulier d’alerte professionnelle (whistle-blowing) dans lequel le whistle-blower est l’objet de représailles.
Pourtant il vaut la peine de revenir sur l’argument culturel. Il n’avait pas été seulement évoqué par Kikukawa, l’ancien président d’Olympus, mais aussi par Woodford lui-même. Le premier affirmait: « Nous espérions qu’il pourrait faire des choses qu’un dirigeant japonais aurait eu du mal à faire. … Mais il a été incapable de comprendre qu’il est nécessaire d’être en accord avec un style de management que nous avons, en tant qu’entreprise, construit depuis 92 ans, et qu’il est tout aussi nécessaire d’être en accord avec la culture japonaise. … [M. Woodford] n’a pas pris en compte notre structure organisationnelle et ses décisions étaient fondées uniquement sur son propre jugement. … Je lui ai dit à maintes reprises qu’il ne pouvait pas agir ainsi, mais il n’a rien voulu entendre. » Quant à Woodford, il avait répondu à l’argument du choc des cultures par un argument du même type : « Je comprends pourquoi le Japon est jugé à ce point « unique » ; il possède l’une des cultures les plus impénétrables pour les étrangers. … Le statu quo a une grande force au Japon. Quand vous changez quelque chose, que vous fermez une affaire ou que vous vous retirez d’une affaire, vous faites face à une résistance – dans mon cas elle était fondée sur les décisions de mes prédécesseurs,– en particulier quand ce qui est en cause est considéré comme inviolable ou sacré. » (New York Times du 14 octobre 2011)
Ces commentaires mettent en lumière le contraste entre une culture individualiste et une culture collectiviste. La remarque de Kikukawa – « [M. Woodford] n’a pas pris en compte notre structure organisationnelle et ses décisions étaient fondées uniquement sur son propre jugement » – est caractéristique de ces deux modèles de culture. On aurait tort d’y voir un fait banal ou purement descriptif. D’abord parce que la culture représente « l’une des sources les plus puissantes d’influence de l’environnement sur les êtres humains », comme l’affirme le psychologue Roger Hock (1). Ensuite parce que les attributs « individualiste » et « collectiviste » jouent un rôle essentiel pour différencier les cultures. Évoquant Harry Triandis, psychologue spécialiste des différences culturelles, Hock souligne que « le degré auquel une culture donnée peut être définie comme individualiste ou collectiviste détermine, par des voies complexes et permanentes, le comportement et les personnalités de ses membres. … Lorsque les cultures sont définies et interprétées en fonction du modèle individualiste – collectiviste, nous pouvons expliquer une bonne partie des variations que nous constatons dans les comportements humains, les interactions sociales et la personnalité ». Par exemple, une culture individualiste se caractérise par une préférence de ses représentants pour affronter les conflits interpersonnels, alors que les membres d’une culture collectiviste ont tendance à dissimuler de tels conflits.
Il n’y a rien d’original à affirmer qu’à travers les traits (complexes) individualistes ou collectivistes, la culture agit comme une force qui dépasse les volontés individuelles. Mais cette affirmation signifie aussi que, dans une certaine mesure, cela ne sert pas à grand-chose d’accabler les acteurs individuels ou collectifs dont les actions sont influencées par de telles forces – même si, dans le cas d’Olympus, ils sont condamnables pour les fraudes qu’ils sont supposés avoir commises – surtout lorsque, comme le dit Woodford, « ce qui est en cause est considéré comme inviolable ou sacré ». L’article des Échos du 30 novembre 2011 avait tout à fait raison de titrer : « « Japan Inc. » à l’épreuve du scandale Olympus ».
Alain Anquetil
(1) R.R. Hock, Forty Studies that Changed Psychology: Explorations into the history of psychological research, New Jersey: Prentice Hall, 2001.