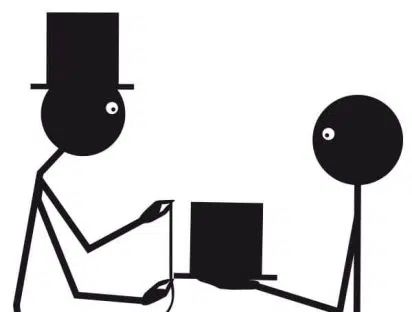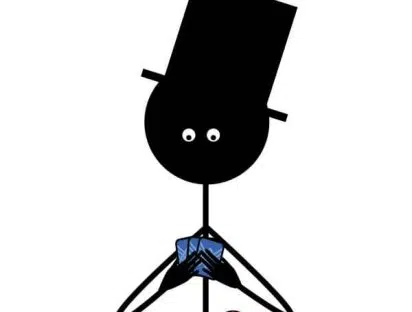Dans un récent billet, l’universitaire et ancien secrétaire au travail américain Robert Reich déplore ce qu’il appelle le « déclin du bien public ». Ce déclin prend deux formes qui sont dépendantes l’une de l’autre : d’une part, la dégradation de la qualité des services fournis par les institutions publiques ; d’autre part, la dépréciation de la valeur accordée à l’idée même d’intérêt général. Il en résulte la croyance que le secteur privé peut avantageusement se substituer au secteur public pour promouvoir le bien commun. Bien que cela puisse sembler étrange à première vue, l’éthique des affaires académique a proposé divers arguments qui visent à promouvoir le bien public. C’est le cas par exemple de certaines justifications apportées à l’alerte professionnelle – ce dispositif grâce auquel, selon la conception américaine, un salarié peut rendre public un problème dont il a connaissance au sein de son entreprise.
1.
À la lecture du billet que Robert Reich a posté sur son blog le 4 janvier 2012, il n’est pas évident d’identifier clairement l’origine du déclin du bien public dans la société américaine. Est-ce l’affaiblissement de l’idée de société qui explique la perte de l’attachement à l’intérêt général et la dépréciation croissante des institutions publiques au yeux des citoyens américains ? Ou est-ce la dégradation des services apportés aux citoyens par les institutions publiques qui a produit un effet dépréciatif sur l’idée de société et entraîné un affaiblissement de la vertu politique (c’est-à-dire la « préférence continuelle de l’intérêt public au sien propre », comme le dit Montesquieu dans l’Esprit des lois) que devrait posséder chaque citoyen ?
Reich ne prend pas vraiment parti pour l’autre ou l’autre alternative en raison du lien étroit qui unit institutions publiques et idée du bien commun. Les institutions publiques incarnent l’intérêt général. Elles reflètent une manière de concevoir la société comme « ensemble de bénéfices et de devoirs mutuels ». Aussi le déclin dont parle Reich concerne-t-il à la fois les institutions publiques et l’idée du bien public. Si ce déclin a eu lieu, c’est, selon lui, parce que les classes moyennes supérieures américaines se sont tournées, à partir de la fin des années 70, vers des institutions privées au détriment des institutions publiques. Mais c’est aussi parce que « l’idée que nous bénéficions tous des biens publics » − que « l’éducation, par exemple, est moins un investissement privé qu’un bien public qui améliore la communauté toute entière et, au bout du compte, la nation » − s’est dépréciée.
Aujourd’hui, affirme Reich, « beaucoup des biens que l’on appelle « publics » sont devenus des biens privés qui sont payés par les usagers – des péages toujours plus élevés pour les autoroutes publiques et les ponts publics, des frais de scolarité plus élevés pour les universités soi-disant publiques, des droits d’entrée plus élevés dans les jardins publics et les musées publics ». Et « l’idée du bien commun s’est affaiblie. Même les Démocrates américains n’utilisent plus l’expression « bien public ». Les biens publics sont désormais au mieux des « investissements publics ». Les institutions publiques se sont transformées en des « partenariats public-privé » ».
Ce constat n’est pas propre à la société américaine. En France, l’ancien Médiateur de la République Jean-Paul Delevoye a justement employé le mot « déclin » dans l’éditorial du dernier rapport (2010) de cette institution : « Notre contrat social n’est pas un contrat de services mais d’engagement. Or, aujourd’hui la citoyenneté décline des deux côtés : celui qui paie l’impôt a perdu la dimension citoyenne de l’impôt et, s’il y consent encore, s’estime néanmoins lésé. De même, celui qui bénéficie de la solidarité publique a perdu le sens de cette solidarité et, ne recevant pas assez, se sent humilié. » Et plus loin dans le rapport : « La notion du « vivre ensemble » s’est encore fragilisée. Plus que jamais, la défense de l’intérêt individuel s’effectue au détriment de celui des autres, sans égard pour les intérêts de la communauté. »
2.
On pourrait croire que l’éthique des affaires académique n’a pas pour mission de s’occuper de ce genre de question. Pour certains, par exemple, elle est avant tout une éthique organisationnelle – une éthique de l’entreprise – qui n’est concernée que de façon indirecte par les questions relevant de l’intérêt général.
Pourtant on trouve, au sein de l’éthique des affaires, des arguments qui défendent la promotion du bien public en tant que telle. Il peut s’agir d’arguments de portée générale comme celui du philosophe politique Christopher McMahon qui défend l’idée selon laquelle « les responsables d’entreprise sont des agents publics d’un certain genre, dont la tâche ultime est de servir le bien public en général » (1) ; ou d’arguments relatifs à la responsabilité sociale et à la citoyenneté de l’entreprise ; ou encore d’arguments portant sur une pratique particulière comme l’alerte professionnelle (whistleblowing). C’est à ce dernier type d’argument, appliqué précisément au cas de l’alerte professionnelle, que je vais me référer pour illustrer la manière dont l’entreprise peut promouvoir le bien public.
Le contexte social et politique américain est un bon point de départ pour traiter de la question. Dans ce contexte, l’alerte professionnelle est souvent définie en fonction du bien public. Sissela Bok, par exemple, affirme que, « comme dans tout acte de dissidence, les lanceurs d’alerte rendent public un désaccord avec une autorité ou un point de vue majoritaire. Mais alors que la dissidence peut naître de toute forme de désaccords – par exemple avec un dogme religieux, la politique du gouvernement ou des décisions de justice,– l’alerte professionnelle a un objectif plus étroit : mettre en évidence une négligence ou un abus, alerter le public sur un risque et assigner une responsabilité relative à ce risque. (…) L’alerte professionnelle ressemble à la désobéissance civile en raison de son caractère transparent et parce qu’elle manifeste une intention d’agir dans l’intérêt public » (2).
Dans un article du Journal of Business Ethics de 2007, Lars Lindblom considère que l’alerte professionnelle peut avoir un caractère politique car elle manifeste le droit fondamental que possède tout salarié à la liberté d’expression (3). Même si, précise-t-il, « la question de savoir si le discours du lanceur d’alerte est de nature politique dépend bien sûr de ce qu’il rend effectivement public », son action peut avoir pour effet de susciter un débat « sur les politiques publiques, voire, dans certains cas, d’entraîner des changements de politiques publiques ».
On peut ajouter à ces considérations académiques la possibilité légale donnée par le False Claims Act à tout citoyen d’agir pour le compte de la collectivité lorsqu’il a connaissance d’une fraude aux dépens de l’État fédéral ou d’un des États américains. Le citoyen agit alors en vertu du principe qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur [celui qui este en justice pour le compte de l’autorité publique comme pour le sien propre]. Ainsi, « le False Claims Act et les lois des États comprennent des dispositions relevant du « qui tam », dispositions qui autorisent les citoyens à intenter un procès, pour le compte de l’État, à des entreprises et à des individus qui commettent des fraudes aux dépens de l’État et, par voie de conséquences, des contribuables » (4).
3.
Ces considérations soulignent le caractère public, au moins dans certains cas (peut-être dans tous les cas), de l’action du lanceur d’alerte. Non seulement il promeut le bien public, mais son action peut, comme le remarque Lindblom, avoir un effet sur les régulations et les institutions publiques. C’est le cas lorsqu’une alerte professionnelle a pour conséquences de renforcer la règlementation sur la sécurité de certains produits et de créer une institution publique, par exemple une agence, chargée de surveiller les pratiques d’un secteur économique donné.
On notera toutefois que, dans le cas français, l’alerte professionnelle n’est pas définie en fonction du bien public. Comme l’indique la CNIL dans Les alertes professionnelles en questions, les destinataires de l’alerte sont uniquement internes à l’entreprise : « Les alertes recueillies [au sein de l’entreprise ] sont (…) vérifiées, dans un cadre confidentiel, et permettent à l’employeur de décider, en connaissance de cause, des mesures correctives à prendre. (…) Le traitement des alertes professionnelles doit être confié à un service ou une organisation spécifiquement mis en place pour traiter ces questions. Les personnes chargées de traiter les alertes doivent être en nombre limité, spécialement formées et soumises à une obligation renforcée de confidentialité qui doit être définie dans leur contrat. »
Dans un article sur les dispositifs français d’alerte professionnelle, Christelle Didier remarquait que « les procédures d’alerte ne trouveront leur utilité que si elles sont perçues comme un moyen d’exercice de la responsabilité des salariés, et pas seulement un moyen de contrôle de tous par tous, que si elles sont conçues pour être au service non des intérêts des entreprises mais de l’intérêt public » (5). Elle avait raison. Et si les dispositifs d’alerte professionnels mis en place dans certaines entreprises sont effectivement « conçues pour être au service non des intérêts des entreprises mais de l’intérêt public », une partie du déclin du bien public que déplore Robert Reich sera peut-être résolue.
Alain Anquetil
(1) C. McMahon, The public authority of the managers of private corporations », in G.G. Brenkert, T.L. Beauchamp (ed.), The Oxford handbook of business ethics (p. 100-125), Oxford University Press, 2010, tr. fr. P. Vellozzo, « L’autorité publique des managers des entreprises privées », in A. Anquetil (dir.), Textes clés de l’éthique des affaires. Marché, règle et responsabilité (p. 331-374), Paris, Vrin, « Textes clés », 2011.
(2)S. Bok, Secrets: On the ethics of concealment and revelation, New York, Vintage Books Edition, 1989.
(3)L. Lindblom, « Dissolving the moral dilemma of whistleblowing », Journal of Business Ethics, 76, 2007, p. 413-426. Le droit à la liberté d’expression a par exemple été rappelé, en France, par l’arrêt n° 2524 du 8 décembre 2009 (08-17.191) de la Chambre sociale de la Cour de cassation relatif à l’alerte professionnelle.
(4) À ce titre, les citoyens plaignants « peuvent recevoir une récompense qui est calculée à partir de la somme récupérée par l’État à la suite du procès ». Ce dispositif incitatif soulève des questions morales. J.T. Moore, «The False Claims Act: A weapon often overlooked », août 2011.
(5) C. Didier, « L’alerte professionnelle en France : un outil problématique au cœur de la RSE », clerse.univ-lille1.fr/IMG/pdf/axe_2_didier.pdf