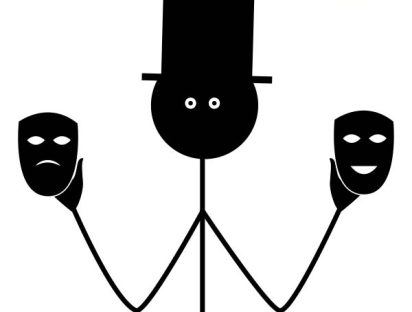Cet été, et hors éditions hivernales, la France accueille les Jeux olympiques pour la troisième fois de son histoire (et paralympique pour la première fois) après 1900 et 1924. Entre mythe et réalité, le premier événement sportif du monde moderne est une source intarissable de scenarii pour le cinéma. Bien souvent dramatiques (Munich, La couleur de la victoire (Race), Richard Jewell, Sans limites (Without Limit), Les Chariots de feu (Chariots of Fire)) avec parfois une pointe d’humour (_Rasta Rockett (Cool Runnings), Eddie the Eagle), nombreux sont les biopics ou films inspirés d’une histoire vraie.
A une époque où l’Histoire s’apprend autant, si ce n’est plus, sur les écrans que dans les livres, revenons sur cette relation entre sport olympique et cinéma.
Le 26 juillet 2024, 205 nations représentées par 10 500 athlètes vont se retrouver à Paris, et quelques autres villes françaises, pour se disputer les 5 084 médailles distribuées dans le cadre des 329 épreuves de l’événement (549 épreuves pour les Jeux Paralympiques). A titre de comparaison, en 1900, seules 24 nations se rencontraient dans le cadre des 95 épreuves programmées.
Nombre de performances et d’histoires vont s’écrire en l’espace de quelques semaines. Certaines auront assurément le privilège de se voir décliner au cinéma. Mais face à la magie authentique du direct, quelle valeur accorder au reflet cinématographique a posteriori du plus grand événement sportif du monde ? A travers trois films qui ont marqué les 40 dernières années, tâchons de répondre à cette question et d’ouvrir notre regard sur les conséquences que génèrent un média tel que le cinéma sur l’histoire olympique.
Plus haut : Eddie the Eagle (2016)
« Lors de ces Jeux, des concurrents ont gagné l’or, certains ont battu des records, et certains d’entre vous ont même volé comme un aigle ». C’est avec ces mots que Franck King, Président du Comité d’Organisation des Jeux olympiques d’Hiver de Calgary (1988), entama son discours de clôture.
Un hommage direct à Michaël Edwards, concurrent britannique ayant terminé dernier des deux épreuves de saut à ski (70 et 90 mètres), il entérine aujourd’hui encore l’un des plus magnifiques échecs héroïques des Jeux olympiques modernes.
Peu entraîné, hypermétrope à un niveau potentiellement paralympique aujourd’hui, et non soutenu par le CIO ni par son propre pays, Michaël Edwards restera l’un des derniers symboles de l’amateurisme courageux cher au baron Pierre de Coubertin. En effet, ses performances seront directement à l’origine d’une règle de limitation des possibilités de qualification des athlètes amateurs mise en place dans la [Charte Olympique en 1990]. En effet, à partir de cette date les normes de performances pré-qualificatives aux Jeux Olympiques sont devenus de plus en plus élevées, rendant bien plus improbables des participations comme celle d’Eddie the Eagle.
Un tel parcours ne pouvant rester cantonné à l’histoire olympique, c’est en 2016 que le réalisateur Dexter Fletcher retrace le parcours de cet athlète pour participer aux Jeux Olympiques dans le film Eddie the Eagle. Un film, présenté tel un biopic, que son protagoniste jugera 90 % non respectueux de la réalité au micro de la BBC en 2015, avant d’atténuer son discours au vu du succès du film.
Pourtant, entre accentuation de l’amateurisme du sportif, caricature surhumaine de son entraîneur joué par Hugh Jackman (en réalité, il a eu plus d’une vingtaine d’entraîneurs), dramatisation des sauts et des relations avec les autres sportifs et de la relation entre le père et l’athlète, la romance prend vite le pas sur la véritable histoire. Si le film présente un savant mélange de moments de bravoure, tendresse et abnégation, il minore la révolution historique provoquée par les deux sauts de Michaël Edwards.
Ces quelques secondes de vol, au cours desquelles il s’élance « tel un aigle » donc, ont suffi à ébranler la pensée originelle des Jeux édictée un 24 juillet 1908 par le Baron Pierre de Coubertin et à élever les barrières à la participation des générations futures d’athlètes amateurs.
Plus fort : Rasta Rockett (1993)
Calgary 1988 : une date historique pour l’amateurisme olympique. Passant des airs à la piste de bobsleigh, c’est encore dans la glace que le cinéma va trouver ici une source d’inspiration. Accueillies froidement par la Fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing, les équipes jamaïcaines de bob à 2 et à 4 participent aux Jeux olympiques de 1988 sans qualification préalable. Le premier fait historique sur le plan olympique est d’ailleurs l’œuvre de l’équipe de bob à 2 puisque le pilote, Dudley Stokes, et son co-équipier, Michaël White, deviennent les premiers athlètes jamaïcains à participer aux Jeux d’hiver. Les performances lors des 4 manches sont anecdotiques, expliquant en partie l’absence de toute référence à cette équipe dans le film Rasta Rockett et l’oubli du caractère pionnier de leur participation, le film se concentrant intégralement sur les épreuves de bob à 4.
La mise en relief de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh en 1988 est en réalité le fruit d’un concours de circonstances médiatiques. C’est la disparition prématurée de l’équipe de hockey sur glace des États-Unis de la compétition (éliminée en phase de groupe) qui oblige les médias américains à focaliser leur temps d’antenne sur une autre épreuve. Ils choisissent l’équipe de Jamaïque de bob à 4, en parallèle de l’équipe américaine qui finira 4e. A l’instar du bob à 2, les performances de l’équipe de Jamaïque de bob à 4, où Dudley Stokes et Michaël White sont toujours présents participant aux deux épreuves, restent anecdotiques. 24e puis 25e des deux premières manches, sur 26 nations participantes, seules les erreurs de départ, casses mécaniques et l’information que l’un des 4 athlètes n’était jamais monté dans un bobsleigh de sa vie avant la compétition, se voient commentées.
C’est la troisième manche qui fera entrer cette équipe dans la légende et lui ouvrira les portes d’une seconde vie cinématographique. Bien que blessé à l’épaule, le pilote Dudley Stokes et son équipe parviennent à réaliser le 7e temps de départ le plus rapide. Au vu de l’inexpérience de cette équipe, c’est un exploit majeur. Cela ne s’arrête pas là puisque lors d’un virage mal négocié, le bob se retourne. Heureusement, l’équipage sort indemne et pousse son bob jusqu’au bout de la piste. L’image restera gravée dans les mémoires… jusqu’en 1993 et sa réécriture cinématographique.
A cette date, le réalisateur Jon Turteltaub est engagé par Walt Disney Pictures pour tourner un film retraçant cette histoire. Dans le film, l’équipe de bob à 4 ne pousse plus son bob jusqu’à la ligne d’arrivée, mais le porte sur ses épaules faisant fit de la blessure de Stokes et de l’impossibilité d’un tel acte au vu du poids de l’engin et de la dangerosité des lames de patins. La photo est belle, certes, mais désinforme sur la réalité des faits et de la discipline pour les néophytes.
Sur le plan de la performance sportive stricto sensu, la troisième manche des Jamaïcains bat tous les records de temps, départ et intermédiaires compris, avant la chute qui elle aussi se voit romancée. Ce n’est plus une erreur de pilotage qui en est à l’origine, mais une avarie progressive du vieux bob prêté dans le film par l’équipe américaine, faisant fi du réel soutien de la fédération américaine bien avant la compétition ayant offert deux bobs et un entraîneur qualifié. Les origines de l’entraîneur sont modifiées, tout comme celle de toute l’équipe où les militaires volontaires sont remplacés par des sprinters ayant manqué leur qualification olympique pour les Jeux Olympiques d’été (fait anachronique en soi puisque les qualifications pour les Jeux d’été ont lieu plus tard).
Mais au-delà des dissonances techniques, c’est l’orientation sociétale du film qui peut poser quelque peu question. En effet, en sus d’une scène de sabotage du bob jamaïquain par un concurrent adverse la veille de la troisième manche (scène finalement coupée au montage), le film met en avant une animosité exacerbée des autres athlètes envers l’équipe jamaïcaine, sur fond d’iniquité sportive mais aussi de racisme à travers le personnage du pilote de l’équipe allemande de l’Est. Cette orientation inexistante sera dénoncée par l’entraîneur de l’équipe, Pat Brown. Néanmoins, encore aujourd’hui, elle reste gravée dans l’imaginaire collectif.
Plus vite : Les Chariots de Feu (1981)
Plus de bob à pousser, plus de matériel, seul comptent le corps et l’esprit dans les Chariots de Feu qui se concentre sur le sport roi de l’olympisme : l’athlétisme. Véritable base cinéphile dans les établissements universitaires de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), ce film raconte le parcours de l’équipe d’Angleterre d’athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, et plus précisément la préparation et les victoires d’Harold Abrahams (100m) et Eric Liddell (400m).
Fondé sur des faits plus anciens que les deux films précédemment présentés, Les Chariots de Feu présente également une autre singularité : l’importance de la patrie. Le patriotisme est ici célébré à travers le sport et les valeurs de l’olympisme entrant en totale résonance avec les principes de vertu et de grandeur irradiant ces jeunes hommes ayant connu la première guerre mondiale sans, pour la plupart, y avoir participé directement du fait de leur âge. En cela, le film présente une grande fidélité aux récits de l’époque après-guerre et du sentiment de devoir chez cette génération d’entre deux guerres. Toutefois, l’œuvre n’est pas exempte d’orientations scénaristiques visant, à l’instar des deux exemples précédents, à accentuer la dramaturgie de l’œuvre au détriment de sa véracité. Deux axes sont dès lors mis en avant en parallèle de la performance sportive en elle-même : l’antisémitisme et la religion. Tous deux sont incarnés respectivement par Abrahams, de confession juive, et Liddell, de confession chrétienne.
Le réalisateur du film, Hugh Hudson, choisit sciemment de modifier l’un des faits les plus marquants de la participation d’Eric Liddell au Jeux : son refus de concourir un dimanche en lien avec sa religion quelques jours avant l’épreuve, provoquant l’opprobre du staff des lords britanniques accompagnant la délégation.
Ce refus de pratiquer la moindre activité sportive le jour du Seigneur pour Eric Liddell est authentique. Mais, le film modifie ce fait sur fond de solidarité entre athlètes britaniques, dans un sport purement individuel à la base, il convient de le noter. Dès lors, dans l’histoire racontée cette potentielle non participation se voit sauvée par un co-équipier anglais, Lord Andrew Lindsay, acceptant de laisser sa place à Eric Liddell sur l’épreuve du 400m se déroulant un jeudi. La véritable histoire, elle, diffère quelque peu. Ainsi, l’information calendaire des Jeux était en réalité connue depuis des mois et la délégation anglaise s’y était adaptée sans réel problème. L’entraînement d’Eric Liddell avait été adapté longtemps à l’avance pour qu’il concoure à l’épreuve des 400m, dans le respect de ses convictions religieuses, épreuve dans laquelle il était également performant et qu’il remporta.
Dans le même ordre d’idée, la mise en avant des difficultés d’Harold Abrahams, liées à sa confession juive, se voit exacerbée et focalisée au sein du récit. Sa mise en parallèle avec son approche professionnelle de l’entraînement (inexistante à l’époque) floute une base historique pourtant essentielle dans l’histoire des Jeux olympiques. Ce choix mystifie l’intégration sans faille de l’athlète au sein de l’équipe britannique, qui avait déjà participé aux Jeux de 1920 à Anvers, et dénature la petite révolution qu’il mettra en marche avec un entraîneur professionnel, Sam Mussabini, à une époque où l’amateurisme est roi ; une révolution du professionnalisme olympique débutée en 1924 et qui se verra, d’une certaine manière, entérinée involontairement par le cas Eddie Edwards en 1988 et la naissance de la Charte Olympique en 1990 limitant la participation des athlètes amateurs.
Ensemble
En 2021, la devise olympique du Père Henri Didon utilisée par le Baron Pierre de Coubertin lors de la fondation du CIO en 1894, a changé. Un mot a été ajouté lors de la 138e session du CIO à Tokyo, passant de « Citius, Altius, Fortius » à « Citius, Altius, Fortius, Communiter », littéralement « plus vite, plus haut, plus fort, ensemble ».
Le cinéma, média rassembleur par essence répond parfaitement à cette évolution de la devise. En prenant des libertés sur les performances sportives et sur la vie des athlètes, il fixe dans l’imaginaire collectif les histoires olympiques les plus marquantes, tout en veillant à parler au plus grand nombre et à s’adapter à son époque. C’est ainsi qu’au-delà des trois films présentés ci-dessus, l’exemple le plus marquant d’usage du cinéma pour réécrire l’histoire olympique reste peut-être la finale de basket-ball masculin des Jeux olympiques de Munich en 1972. En 2018, la superproduction patriotique russe Dvijenie vverkh (« Trois secondes » en Français) vient donner un énième point de vue de l’histoire de cette finale remportée par la Russie d’un point sur les États-Unis ; victoire entourée de nombreuses polémiques.
Cet exemple extrême, tout comme Eddie the Eagle, Rasta Rockett ou les Chariots de Feu à un degré moindre, corrobore l’idée que le cinéma sait valoriser les exploits sportifs réalisés lors des Jeux olympiques. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le spectacle y prend souvent le pas sur les faits historiques ; particulièrement au vu de son importance grandissante dans les schémas éducatifs des générations actuelles. Ce recul est essentiel pour que la réalité des exploits passés conserve sa véracité et ne se voit pas remplacée par des récits contés toujours plus vite, toujours haut, toujours plus fort.