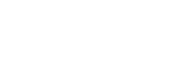Le numéro 54 de la revue Question(s) de management (avril 2025) consacre un cahier spécial aux entreprises familiales et aux enseignements qu’elles offrent face aux dynamiques actuelles du monde des affaires. Les chercheurs et membres affiliés de l’Institut des entreprises familiales de l'ESSCA ont été sollicités pour répondre à la question suivante :
« À l’heure des start-ups et des GAFAM, quels enseignements peut-on tirer des PME et ETI familiales ? »
La relation au temps « ordre des coexistences et des successions » selon Merleau-Ponty, fut profondément renouvelée depuis la fin du XXe siècle. La perspective du temps long qui jadis, structurait l’effort, a perdu sa dimension aspirationnelle. Les sociologues post-modernes ont qualifié cette transition de passage d’une société sotériologique (orientée vers le salut) vers des idéaux immanents, souvent résumés par la revendication du hic et nunc (ici et maintenant). Ce changement des comportements humains affecte les dynamiques managériales.
Les entreprises familiales sont disposées au temps long, au cours duquel la transmission entre générations soulève la criticité de la perpétuation du projet et des avantages concurrentiels développés.
Le début du XXIe siècle a consacré le développement de modèles d’affaires reposant sur des actifs numériques, assortis d’audaces entrepreneuriales inédites : prendre un risque de création coûte moins si toutefois l’aventure se révélait infructueuse. A contrario, le succès peut valoriser l’entreprise largement au-delà de ses actifs. La motivation expérientielle peut dominer les tentatives entrepreneuriales furtives, nonobstant la prise en considération des parties prenantes associées aux projets. L’inscription dans la durée n’est pas considérée comme une nécessité première.
Ces constats pourraient questionner l’attractivité et la compétitivité des entreprises familiales. Le temps dans lequel elles s’inscrivent leur permet de trouver le point d’équilibre décisif de quatre concepts oscillant du risque à l’avantage concurrentiel : la logique entrepreneuriale, la confiance, l’incarnation du projet stratégique et enfin, l’exercice du leadership.
Les logiques entrepreneuriales : présumer leur homogénéité d’une entreprise familiale l’autre serait réducteur. Voici près de 30 ans, Marchesnay et Julien avaient dressé les profils PIC et CAP selon la prédilection patrimoniale ou orientée vers la prise de risque des entrepreneurs. A ce titre Yvon Gattaz, qui a marqué de ses mandats de président le CNPF et l’ASMEP remarquait avec malice : « Pour la succession des entreprises familiales, les patrons se partagent en deux catégories : ceux qui croient que le génie est héréditaire et ceux qui n’ont pas d’enfants ». Soyons confiants dans la capacité des entreprises familiales à prendre des risques, à renouveler leurs modèles d’affaires. La conscience de leurs dirigeants d’être légataires d’un projet qui transcende leur mandat, est propice à l’exercice non-compté de leur responsabilité.
La confiance auprès des parties prenantes : les réputations se bâtissent dans le temps long et sont essentielles aux affaires, ainsi que le rappelait l’économiste Ian MacNeil dans son Nouveau contrat social : la confiance précède le contrat. La transposition des liens familiaux à l’organisation de l’entreprise familiale, la rend apte à susciter la confiance auprès de ses parties prenantes : collaborateurs, clients, partenaires, pouvoirs publics, notamment.
L’incarnation du projet stratégique : Les entreprises familiales ont pour figures emblématiques leurs dirigeants, pas nécessairement fondateurs. Chaque génération marque de son empreinte la trajectoire concurrentielle de l’entreprise. A titre d’illustrations, songeons aux dynasties Ford, Rockfeller, Dassault…
L’exercice du leadership dans les décisions managériales : par la présence de la famille dans l’entreprise pointe le risque de choix managériaux désalignés de ce que la rationalité commanderait. Ainsi, Lambrecht et Lievens (2008) caractérisaient les dirigeants familiaux comme des CEO pour chief emotional officers, devant ajouter à la complexité des affaires, celle des liens familiaux. L’Histoire de l’Entreprise retiendra la précipitation dans la crise économique que connurent les industries textiles et sidérurgiques de l’Est de la France dans les années 1970, devant pour certaines entreprises assurer de manière anachronique le train de vie de dynasties, à contre-courant des choix courageux qui s’imposaient.
Les aventures entrepreneuriales se nourrissent autant de créations que de transmissions. Les entreprises familiales constituent le pont robuste reliant les rives de l’accompli à celles du possible.