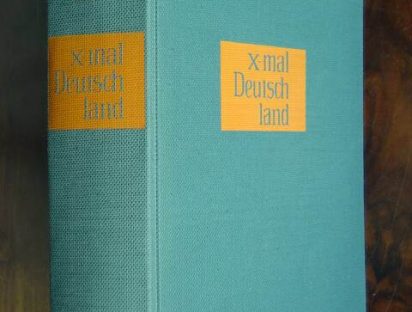Chronique dans la matinale d’Euradio du 11 avril 2019 :
La première lingua franca européenne était le latin, réservé il est vrai au monde des monastères et des premières universités. S’il est aujourd’hui un peu risqué de dispenser des cours magistraux en latin, il y a des expressions comme « sui generis » qui s’avèrent fort utile en science politique, notamment quand il s’agit d’études européennes.
« Generis » est le joli génitif du mot « genus », qui est à l’origine du mot « genre » en français, et de cette expression « sui generis », le dictionnaire nous dit qu’il signifie justement « de son propre genre ». Une expression qui décrit une personne ou une chose qui possède des caractéristiques particulières, de sorte qu’elle ne rentre dans aucune catégorie habituelle.
En science politique, s’il y a un objet identifié comme une entité véritablement « sui generis », c’est bien l’Union européenne. Ce n’est ni un Etat, ni une fédération d’Etats, ni même une confédération, c’est une construction qui ne rentre dans un aucun tiroir. Là-dessus, il y a « consensus » (autre mot latin dont l’application reste rare !)
Bien entendu, que l’Union européenne soit un OVNI politique et juridique, ce n’est pas vraiment un scoop. Cela fait un moment que les professeurs l’enseignent à leurs étudiants, et cela fait belle lurette que les acteurs politiques et médiatiques ont bien intégré ce fait. En théorie, du moins.
Dans la pratique, c’est moins évident. Une campagne électorale comme celle que nous vivons ces jours-ci pour le parlement européen, et les arguments qui y sont avancés, montrent bien que cette singularité « hors catégories » de l’Union européenne s’exprime tout d’abord dans l’architecture de ses institutions et que celles-ci restent déstabilisantes, voire déroutantes pour plus d’un.
Y compris au sein même de ces institutions. Prenez le système des « Spitzenkandidaten », ces têtes de listes nommées par les groupes du parlement européen pour le poste de Président de la Commission européenne à pourvoir en automne. Cela part sans doute d’une bonne intention, celle de « faire plus démocratique », mais cela n’aurait de sens que si la Commission était un véritable gouvernement formé par une majorité issue des urnes. Ce qui, de toute évidence, n’est ni sa fonction ni sa vocation.
C’est quand même stupéfiant : quand on prend le temps d’expliquer l’architecture institutionnelle européenne, en la présentant comme innovante, conçue pour répondre au mieux aux besoins d’une communauté d’un ordre nouveau – « sui generis », justement – et ajustée au fur et à mesure par les membres de cette communauté, tout le monde est capable de saisir l’originalité de la construction et les raisons pour lesquelles elle est devenue ce qu’elle est.
Mais dès qu’on la met en comparaison avec les cadres institutionnels habituels, qui sont en vigueur dans les différents Etats-membres – et dont, soit dit en passant, aucun ne donne entière satisfaction à la population en question – l’Europe paraît déficiente. On lui découvre aussitôt un déficit démocratique, un déficit d’efficacité, un déficit de représentativité.
Une seule explication : nous avons, que nous soyons journalistes, universitaires, élus ou simple électeurs, subi un véritable conditionnement de notre esprit par l’Etat-nation.
L’Etat-nation a imposé un cadre de pensée « normatif » sur notre imaginaire politique. Autrement dit: il nous prescrit ce qui doit être perçu comme « normal ». Tout ce qui sort de ce cadre est « déviant », ou « utopique ». Toute alternative est mesurée à l’aune de l’Etat-nation, celle qui nous est familière, celle qui définit le champ du possible. L’Union européenne a beau être dans le paysage depuis des décennies, elle reste une « anomalie ».
Ce sont les philosophes qui ont le mieux compris à quel point c’est un exercice exigeant pour l’individu contemporain, programmé à penser la gouvernance démocratique à travers le prisme de l’Etat-nation, d’élargir encore sa perspective.
Tout porte à croire que le processus d’intégration européenne est un processus d’émancipation de grilles de lecture anciennes que nos pauvres cerveaux ont du mal à effectuer. Selon Jürgen Habermas, grand théoricien de la « constellation post-nationale », nous avons fait un énorme effort d’abstraction en passant de l’ère féodale à la modernité des Etats-nations, et aujourd’hui, la nécessité d’imaginer un cadre post-national ou supranational nous demande encore un « saut » d’abstraction important. On n’y est pas encore, clairement.
Avant lui, Norbert Elias s’étonnait, dans ses dernières publications datant des années 1980, de « l’opiniâtreté » qui caractérise « l’habitus social national des ressortissants d’un Etat national ». Il est allé jusqu’à parler de « fossilisation » de cet « habitus », décrivant l’homme moderne comme attaché (dans tous les sens du terme !) à son appartenance nationale traditionnelle, alors que l’évolution de son environnement – politique, économique, écologique – lui demande d’inventer un cadre de référence nouveau, hors les sentiers battus, « sui generis », justement.
Image à la une de Tingey Injury Law Firm sur Unsplash