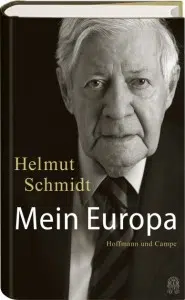
« Son Europe » n’était pas l’histoire d’une relation amoureuse. Avec le réalisme pragmatique qui caractérise les Hambourgeois et que les Allemands aiment à appeler « hanséatique », il soulignait régulièrement qu’il n’était point besoin d’être « un idéaliste européen ». Au contraire : il lui semblait parfaitement suffisant de reconnaître que l’Allemagne avait un « intérêt stratégique » à se faire le promoteur d’un processus d’intégration européenne dont elle bénéficiait de multiples façons.
Helmut Schmidt avait une grande admiration intellectuelle et affective pour Jean Monnet qu’il invita à plusieurs reprises, à titre privé, dans la chancellerie de Bonn pour le consulter sur le destin de l’Europe. Comme Monnet, il était convaincu que les Européens étaient d’abord des êtres « rationnels ». Lorsqu’on lui demanda, à l’occasion de ses 95 ans en 2014, s’il avait un souhait, il répondit : « Mon souhait est que les Allemands comprennent qu’il faut achever la construction de l’Union européenne, et non pas nous mettre au-dessus d’elle. »
Alors qu’il avait, en tant qu’homme de l’Allemagne du Nord, une plus grande affinité naturelle avec la culture et la langue anglaises qu’avec la France, il n’oublia jamais ce que la jeune République fédérale devait aux visionnaires qu’étaient Monnet et Schuman. « En 1950 », écrivit-il dans ses mémoires publiées en 2008, « le plan Schuman m’apparaissait comme un coup de chance immérité pour l’Allemagne ». Et depuis sa retraite de la vie politique active, il ne cessa de rappeler à ses successeurs, de Kohl à Merkel, en passant par Schröder, de « ne jamais rien faire sans la France ! »
Valéry Giscard d’Estaing lui sembla être le digne héritier des pères fondateurs de l’Europe. Ils sont restés liés par une amitié sincère et réciproque durant près d’un demi-siècle, une complicité assez surprenante vu la grande disparité culturelle entre l’aristocrate français et le social-démocrate nordique d’origine modeste.
Bien sûr, comme son ami français, il céda parfois à la tentation de critiquer le « manque de leadership » des dirigeants européens aujourd’hui. Tout en reconnaissant que la Communauté des Neuf qu’ils avaient contribué à développer et à fortifier, avait été plus facile à gérer que l’Union des vingt-huit d’aujourd’hui. Avec la liberté de parole de l’homme d’État en retraite, il aimait à en appeler à un « putsch » du Parlement européen pour secouer un cadre institutionnel qu’il n’estima plus approprié, et pour contrecarrer les tendances à la « ré-nationalisation » de l’esprit communautaire qui semble actuellement être à l’œuvre.
Hemut Schmidt est décédé hier à l’âge de 96 ans. Ce qui restera de ce grand Européen, qui a navigué dans une république encore jeune et fragile à travers des années très difficiles sans lui faire perdre le cap de la démocratie, ce sont des convictions et des valeurs. Cette conviction profonde que le plus grand accomplissement de l’Europe de l’après-guerre est l’État providence et qu’il faut tout faire pour en préserver les principes malgré les assauts d’un capitalisme débridé. Et cette façon de ne pas soumettre son intelligence brillante à une ligne idéologique dictée par un parti, mais de trouver les fondements éthiques de son action dans quelques valeurs apolitiques et non-négociables. « Liberté, justice et solidarité » – c’était sa mise à jour personnelle de l’héritage de la Révolution française, les piliers de « son Europe ».




