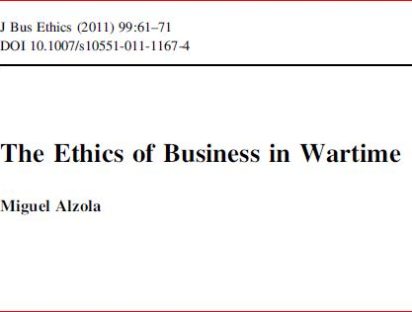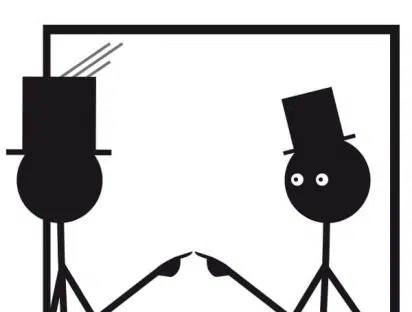Le mot « post-vérité » (post-truth) a été considéré par le dictionnaire Oxford comme le mot de l’année 2016. Il ne signifie pas : « après que la vérité fut connue », ce qui le rendrait peu original. Il se réfère plutôt à l’idée que « la vérité elle-même est devenue hors de propos ». Plus précisément, il qualifie, selon les termes du site, « des circonstances dans lesquelles, pour façonner l’opinion publique, les faits objectifs ont moins de poids que le recours aux émotions et aux croyances personnelles ».
Le mot aurait pris son envol grâce à deux événements de l’année 2016 : le Brexit et l’élection de Donald Trump. Ont suscité son usage la manière dont des faits ont été déformés ou ignorés à l’occasion des campagnes précédant ces événements ; l’usage ostensible du mensonge avant et après les élections en question ; ou encore la reconnaissance pure et simple, sans scrupule moral apparent, de mensonges antérieurs (1). Les commentaires de certains médias, par exemple de France Culture, y ont aussi contribué (2).
L’émergence de l’idée de post-vérité au sein de certains discours publics contribue à dessiner ce que pourrait être l’année 2017, y compris dans le domaine économique. Elle devrait sans doute nourrir notre premier sujet de réflexion de l’année, que nous avons intitulé, pour une raison qui apparaîtra plus loin : « 2017, le nouvel ordre du monde et l’éthique des affaires ».
Inutile toutefois de chercher la trace de la post-vérité dans l’éthique des affaires académique. Le mot n’est mentionné dans aucune des trois revues principales de langue anglaise qui représentent cette discipline (3) – il faut dire que son invention est plutôt récente. Mais certains travaux de recherche s’y rapportent indirectement. Nous nous y réfèrerons pour traiter de notre sujet. Et nous le ferons après un détour par les arguments avancés fin 2016 par le professeur de sciences politiques Francis Fukuyama sur l’idée de « post-vérité » et sur le « nouvel ordre du monde ». Le présent billet est consacré à ses arguments. Le prochain examinera leurs résonances dans l’éthique des affaires.
1.
Le 5 octobre 2016, dans une vidéo postée sur le site de l’université Stanford, Fukuyama aborde en peu de mots la question de « la société de la post-vérité » (« Francis Fukuyama: The post-truth society »). La campagne de l’élection présidentielle américaine arrivait alors à son terme, mais Fukuyama n’y fait qu’une allusion.
Son argument comprend trois parties. D’abord, un rappel du sens immédiat de l’idée de post-vérité. Celle-ci se traduit par le fait que, selon la description de Fukuyama, « il est possible de supposer vraies des choses qui ne sont pas fondées sur des faits ». Et le fait que des critiques s’élèvent contre ces prétendues vérités, des critiques provenant par exemple de « vérificateurs » (les fact-checkers), n’y change absolument rien. Fukuyama utilise une expression imagée qui rend compte de cette idée : la post-vérité se développe « dans des territoires indéfinis où n’importe quoi peut arriver » (undefined territory where anything can go).
Dans une seconde partie, il aborde ce que la post-vérité recouvre plus profondément. Elle révèle le déclin de l’autorité des institutions qui, depuis une cinquantaine d’années, ont structuré les sociétés libérales occidentales : entreprises, syndicats, famille, églises, partis politiques. Ce déclin a pour contrepartie une érosion de la confiance des citoyens en ces institutions.
La dernière partie porte sur les causes de ce déclin et de cette perte de confiance. La question est difficile, mais Fukuyama avance une cause notable : l’effet de la technologie sur la visibilité des institutions, c’est-à-dire le fait que leurs pratiques sont désormais aisément observables par le public. Prenant l’exemple de la police américaine, Fukuyama note ainsi que « lorsque les gens voient la manière dont elle fonctionne dans la réalité, ils deviennent mécontents ».
2.
Abordons maintenant les arguments qu’il propose à l’égard de ce qu’il appelle le « nouvel ordre du monde ». Dans un article publié dans le Financial Times le 11 novembre 2016, il traite de ce qu’il appelle l’« internationale populiste nationaliste » (« US against the world? Trump’s America and the new global order »). Ce qu’il y décrit, et dont il dénonce les dangers, peut être relié à la post-vérité, même si ce concept n’est pas cité dans l’article.
Selon Fukuyama, le nouvel ordre du monde dans lequel nous sommes entrés, ou dans lequel nous sommes en train d’entrer, est celui du « nationalisme populiste ». L’ancien monde était l’ordre libéral. Il avait permis en particulier un fort développement économique à l’échelle mondiale. Le nouvel ordre n’y ressemblera pas. Il marquera un « tournant décisif ».
Dès le début de l’article, Fukuyama souligne les dangers de ce changement de monde :
« Il semble que nous entrions dans une ère nouvelle de nationalisme populiste au sein de laquelle l’ordre libéral dominant, bâti depuis les années 1950, est devenu la cible de majorités démocratiques en colère et particulièrement mobilisées. Le risque de basculer dans un monde de nationalismes compétitifs et colériques est très grand. Si le basculement se produit, il en résultera un tournant aussi critique que la chute du mur de Berlin en 1989. »
Mais le point intéressant, pour notre propos, est le volet économique de ce supposé changement de monde. La disparition d’emplois dans les pays traditionnellement industrialisés à cause d’un « marché mondial à la compétition impitoyable », les crises d’un « système conçu par les élites » (Fukuyama cite la crise des subprimes et la crise de l’euro), dont les conséquences ont touché les travailleurs ordinaires et non les élites, ont alimenté le populisme qui a émergé en 2016. Parallèlement, une recherche d’identité fondée sur la « communauté culturelle fondamentale » qu’est la nation tente de se substituer à une identité relative à l’appartenance à une classe sociale.
Le « nationalisme populiste » que décrit Fukuyama est le résultat de ces mouvements. Ses conséquences possibles ne concernent pas seulement la sphère politique. Elles intéressent également la sphère économique. Si l’on part de l’hypothèse que les États-Unis pourraient adopter une ligne économique nationaliste (hypothèse plausible car, selon Fukuyama, Donald Trump a, à cet égard, « une position cohérente et longuement réfléchie »), il pourrait en résulter « un changement unilatéral des termes du contrat ». Or, souligne-t-il, « il existe beaucoup d’acteurs puissants dans le monde qui seraient heureux de trouver là une occasion de se venger et de déclencher une spirale économique infernale comparable à celle des années 1930 ».
Au-delà de cette hypothèse pessimiste, il y a, dans les arguments proposés par Fukuyama, des considérations dont on trouve un écho dans quelques travaux de recherche en éthique des affaires. Nous en discuterons dans le prochain billet.
Alain Anquetil
(1) Voir par exemple « Brexit : shame on you, Boris ! » (Le Monde, 1er juillet 2016) à propos de Boris Johnson, l’un des partisans du « Leave » : « […] Boris Johnson, dans un tardif accès de franchise, a reconnu, dès le 27 juin, qu’il serait impossible de tenir les promesses de la campagne ».
(2) Voir par exemple « L’Âge des foutaises » dans l’émission Le tour du monde des idées . On pourra aussi se référer aux articles de Libération (« Post-truth », 16 novembre 2016) et du Monde (« Les médias dans l’ère de la politique post-vérité », 12 juillet 2016).
(3) Journal of Business Ethics, Business Ethics Quarterly et Business Ethics : A European Review.
[cite]