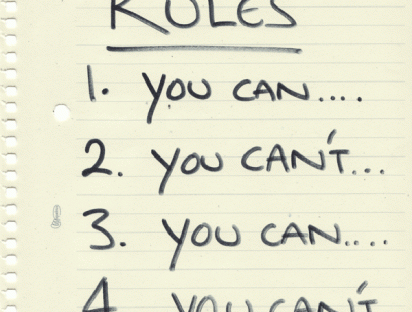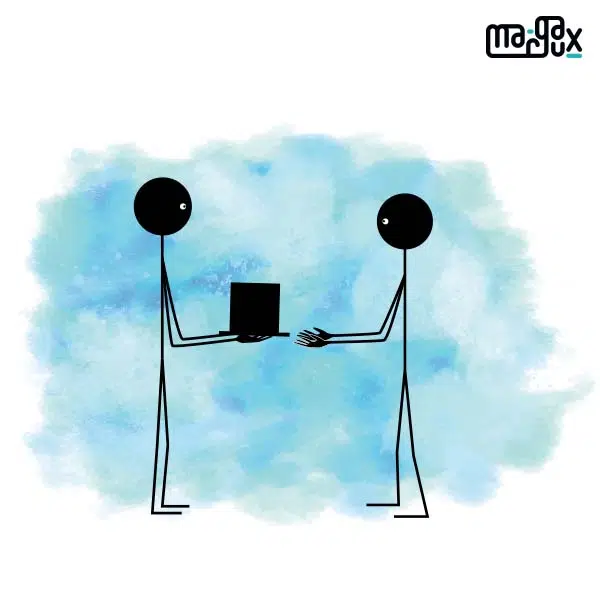
Edwin Hartman, philosophe spécialiste de l’éthique des affaires, affirme que « la confiance, la fiabilité et la coopération » sont, parmi « les vertus collectives, cruciales pour la réussite de nombreuses entreprises » (1). L’intuition nous conduit sans doute à nous accorder avec ce propos, qui pourrait s’étendre à d’autres « personnes collectives », par exemple des gouvernements. Il suppose cependant que la réalité de l’existence de « vertus collectives » – c’est-à-dire des propriétés intrinsèques d’une organisation (l’équivalent de traits de caractère) dont elle a besoin pour se développer (2) – soit démontrée. Dans cet article, nous évaluons un argument en faveur de l’existence de telles vertus.
1.
Introduction
Hartman justifie son propos en affirmant que « la confiance et la fiabilité (trustworthiness) […] sont d’une importance vitale dans la plupart des organisations, et [qu’]elles génèrent des biens internes qui ne sont pas sans rappeler ceux de l’amitié » (3). Cette justification de la réalité des vertus collectives est fondée sur leurs conséquences. Elles sont censées bénéficier non seulement aux organisations elles-mêmes (via la réalisation de « biens internes » comme le travail bien fait), mais aussi à leurs parties prenantes.
Cette caractéristique a été discutée par la philosophe Philippa Foot à propos de la vertu relative à la personne « individuelle », qui constitue le sujet habituel des vertus (4). Elle a proposé d’autres caractéristiques que nous présentons à la section 2. Mais il est utile, pour poser le problème, de dire un mot de travaux qui ont cherché à définir les conditions de possibilité des vertus collectives.
Par exemple, T. Ryan Byerly et Meghan Byerly ont proposé une conception inspirée des travaux de philosophes des sciences sociales, selon lesquels il est possible d’attribuer à un groupe humain des croyances et des intentions comme on le fait à une personne singulière. Pour ces auteurs, comme pour d’autres, il serait également possible de lui attribuer des vertus – des vertus « collectives » (5).
Cette hypothèse peut être vérifiée de deux façons. Soit on considère que, pour que l’on puisse affirmer qu’un groupe humain possède une vertu, il est nécessaire que tous ses membres, ou la plupart d’entre eux, possèdent et exercent cette vertu. Cette vision reprend la conception dite « sommative » des croyances de groupe. Selon la philosophe Margaret Gilbert :
« Un groupe croit que p [p désignant une proposition quelconque] si et seulement si la plupart de ses membres croient que p » (6).
Cette définition peut être transposée aux vertus, moyennant l’établissement d’un lien conceptuel entre croyance et vertu (7). Une conception sommative des vertus impose des contraintes d’autant plus significatives à l’attribution de vertus à une collectivité que celle-ci comprend un grand nombre de membres. Elle peut en revanche s’appliquer en théorie à de petits groupes homogènes ou à des collectivités humaines importantes dont le processus de décision est centralisé et qui sont influencées par la figure de leurs dirigeants. S’agissant de ce dernier point, Per Sandin notait que, lorsque l’éthique de la vertu est invoquée pour expliquer la conduite vertueuse d’une entreprise confrontée à une crise majeure, on peut confondre les soi-disant vertus de l’entreprise avec les vertus de ses dirigeants (8).
Selon la conception opposée, dite « non sommative » – qui est notamment défendue par Gilbert en ce qui concerne les croyances –, attribuer une vertu à un groupe humain suppose que ce groupe possède des propriétés que ses membres ne possèdent pas. Byerly et Byerly observent que, « si les conceptions non sommatives sur les attributions de vertus collectives [à des groupes] sont correctes, alors il existe des vertus collectives ».
Les arguments qui soutiennent la conception non sommative reposent sur le fait que les membres d’une organisation agissent en tant que membres de cette organisation et qu’ils s’engagent conjointement à réaliser les fins et les valeurs qui sont visées par ces vertus. Par exemple, la vertu de patience permet de réaliser certains objectifs en garantissant un rythme adéquat dans le travail commun et en permettant à d’autres vertus et compétences de s’exprimer au sein du groupe, par exemple l’esprit critique ou la créativité (9).
2.
Les caractéristiques de la vertu selon Philippa Foot
L’historien Per Sandin défend la thèse selon laquelle « il est possible et raisonnable d’attribuer des vertus collectives, du moins à certains types de collectivités » (10). Ces « collectivités » sont des « collectivités agglomérées », c’est-à-dire des « organisations [qui] peuvent persister dans le temps, même si leurs membres changent » (11). L’argument de Sandin repose sur les distinctions proposées par Philippa Foot.
Elle défend trois thèses relatives aux vertus individuelles :
a) les vertus sont bénéfiques et les vices, nuisibles ;
b) la volonté est nécessaire à l’exercice des vertus morales ;
c) les vertus sont correctives au sens où leur fonction est de lutter contre les tentations.
a) Nous avons signalé dans la première section que les vertus profitaient au bien-être des personnes qui les exerçaient, comme à d’autres personnes qu’elles peuvent concerner. Il en est de même pour les vices : l’orgueil, la vanité et l’avarice nuisent à la personne qui les possède comme à celles avec lesquelles elle est en relation.
« Il est possible et raisonnable d’attribuer des vertus collectives, du moins à certains types de collectivités »
Foot l’exprime de façon explicite :
« Il semble clair que les vertus sont, d’une manière générale, bénéfiques. Sans elles, les êtres humains ne vivent pas bien. On ne peut vivre bien si l’on manque de courage et si l’on ne possède pas un minimum de tempérance et de prudence, et les communautés humaines où la justice et la charité font défaut sont susceptibles de devenir invivables, à l’instar de la Russie sous la terreur stalinienne ou de la Sicile sous la mafia. »
Toutefois, cette caractéristique ne suffit pas à définir une vertu. En effet, d’autres propriétés des êtres humains, comme la santé, les capacités intellectuelles et la force physique, sont également bénéfiques et leur défaut, nuisible.
b) « Les vertus appartiennent à la volonté », affirme Philippa Foot. C’est que la volonté, conçue comme un événement mental qui précède et détermine l’action (12), est nécessaire à l’exercice des vertus morales. Pour posséder effectivement une vertu, il convient d’agir intentionnellement. Avoir l’intention d’être courageux ou généreux ne suffit pas : il faut effectivement être courageux ou généreux. Cela vaut aussi pour la prudence, bien qu’elle soit souvent décrite comme une vertu intellectuelle, séparée de la sphère de la volonté.
Foot précise que, contrairement à une compétence, une vertu n’est pas « une simple capacité : elle doit effectivement engager la volonté ». Un professeur de piano peut volontairement faire une fausse note pour montrer à son élève ce qu’il ne faut pas faire. Cet acte ne remet pas en cause sa compétence de pianiste. Mais une personne ne peut de la même façon manquer de courage volontairement dans une situation donnée. Si c’était le cas, cet acte remettrait en cause sa disposition à être courageuse. Cette distinction illustre, selon Foot, le lien intrinsèque qui unit la vertu et la volonté.
Avoir l’intention d’être courageux ou généreux ne suffit pas : il faut effectivement être courageux ou généreux.
c) Les vertus morales ont aussi pour fonction de repousser les tentations. C’est en ce sens qu’elles sont « correctives », selon le mot de Foot. Par exemple, la tempérance est en quelque sorte activée lorsqu’un désir immodéré se présente. Son rôle est alors de « corriger » ce désir. La peur joue le même rôle dans l’activation du courage.
Philippa Foot en tire une conclusion relative à la raison d’être des vertus :
« C’est uniquement parce que la peur et le désir fonctionnent souvent comme des tentations que le courage et la tempérance existent en tant que vertus »,
qu’elle étend à la nature humaine :
« Si la nature humaine avait été différente, les dispositions correctives n’auraient pas existé puisque la peur et le plaisir auraient fort bien guidé la conduite des êtres humains tout au long de leur vie ».
Certaines vertus n’ont pas pour fonction de corriger des tentations. C’est le cas de la bienveillance. Mais elle joue toutefois un rôle correctif dans la mesure où elle corrige un défaut de sollicitude pour autrui, de même que la justice corrige un défaut de prise en considération des droits d’autrui.
3.
Application à la vertu collective
Per Sandin reprend la conception de Philippa Foot pour justifier l’existence de vertus collectives (13). Elle lui paraît susceptible de s’appliquer non seulement à des personnes individuelles, mais aussi à des personnes collectives – elle « ne présuppose pas que les humains sont le seul type d’objet auquel les vertus peuvent être attribuées ». Sa définition de la vertu reprend quasi strictement celle de Foot ;
« Une vertu est une caractéristique d’un agent qui a) est bénéfique à l’agent lui-même et aux patients moraux, b) engage la volonté et n’est donc pas une compétence, et c) est corrective ».
Sandin ne réduit pas son argument à la seule vérification que les critères de Foot s’appliquent à une collectivité. Il propose deux observations préalables qui vont à l’appui de l’existence de vertus collectives. D’abord, c’est un fait du langage ordinaire que l’on attribue fréquemment des croyances, des désirs, des intentions et des vertus à des organisations. On fait comme si elles avaient la même puissance d’agir et la même constitution que des êtres humains. Mais ce « comme si » peut révéler autre chose qu’une simple commodité de langage. Ensuite, certaines organisations sont stables dans le temps. Or, Sandin estime que cette propriété est une « condition préalable à la vertu ». Elle permet d’établir une analogie entre les « structures constitutives » d’une organisation et le caractère d’une personne, lequel inclut des vertus. (14)
La fiabilité d’une entreprise est une vertu collective
Pour montrer que les critères de Foot peuvent s’appliquer à des collectivités, Sandin propose l’exemple de la vertu de fiabilité (trustworthiness) – le fait d’être digne de confiance – de l’entreprise. Selon lui, cette vertu remplit aisément les conditions a) et c). En effet, la fiabilité d’une entreprise lui profite et profite à ses parties prenantes, et elle permet d’éviter (de « corriger ») les mauvaises tentations (Sandin propose l’exemple de la tentation de ne pas rappeler des produits défectueux).
Mais la condition b) est plus difficile à satisfaire puisqu’elle suppose de définir précisément la volonté d’une entreprise. Appliquer à une entreprise l’affirmation de Foot selon laquelle « la vertu doit effectivement engager la volonté » suppose que tous les termes (la vertu, la volonté et la connexion entre les deux) soient spécifiés.
Sandin n’entreprend pas ce travail. Il reprend seulement la distinction que fait Foot entre vertu et compétence pour l’appliquer à la fiabilité. Supposons qu’une entreprise fasse « des déclarations trompeuses sur la sécurité de ses produits », violant ainsi, en apparence, sa vertu de fiabilité. Pourrait-on en conclure que cette entreprise serait néanmoins digne de confiance, comme notre professeur de piano demeurait compétent après avoir fait délibérément des fausses notes ? Non, et ceci confirme, selon Sandin, l’idée que la fiabilité est une vertu collective.
La conclusion est intéressante. Elle a le mérite, comme le montre l’exemple de la fiabilité, de distinguer, au sein des qualités d’une organisation, ce qui relève des capacités indépendamment de son « caractère » (ou de sa culture, de son identité ou d’autres termes du même ordre) et ce qui relève des « vertus » qui, elles, dépendent du « caractère ». Elle a aussi le mérite de reposer sur une définition pragmatique et « opérationnelle » de la vertu. Mais elle ne rend pas compte de la complexité psychologique de la vertu individuelle et se confond avec la notion de valeur, qui est si populaire dans le monde des organisations. Ce sont des objections problématiques, du moins si l’on veut conserver le mot « vertu » pour qualifier certaines propriétés collectives des organisations.
Alain Anquetil
(1) E. Hartman, « The virtue approach to business ethics », in D. C. Russell (dir.), The Cambridge companion to virtue ethics, Cambridge University Press, 2013.
(2) D’après la définition que donne Rosalind Hursthouse d’une vertu individuelle (« Virtue theory and abortion », Philosophy and Public Affairs, 20, 1991, p. 223-246).
(3) Ibid. Les biens internes doivent être compris comme des biens spécifiques à une pratique ; ils reflètent en quelque sorte la raison d’être d’une entreprise (voir par exemple « La poursuite des biens internes expliquerait l’amour du public pour le Tour de France », 30 juillet 2018).
(4) P. Foot, « Virtues and vices », in R. Crisp et M. Slote (dir.), Virtue ethics, Oxford University Press, 1997. Reproduit dans P. Foot, Virtues and vices and other essays in moral philosophy, Oxford University Press, 2002.
(5) T. R. Byerly & M. Byerly, « Collective virtue », The Journal of Value Inquiry, 50, 2015.
(6) Il s’agit de la conception sommative simple. M. Gilbert, « Durkheim and social facts », in H. Martins et W. Pickering (dir.), Routledge,1994, tr. E. Betton-Gossart, « Durkheim et les faits sociaux », in Marcher ensemble. Essais sur les fondements des phénomènes collectifs, PUF, 2003.
(7) Ce que proposent Byerly et Byerly en associant des attributions de vertus à une organisation à des dispositions de ses membres à croire et à agir en tant que membres. A titre d’illustration, ils proposent le cas d’un chercheur prudent dans son travail de recherche qui, du fait de sa vertu de prudence, aura tendance à croire la thèse apportant l’explication la plus étayée d’un phénomène.
(8) Per Sandin critique ainsi les exemples spectaculaires (notamment le cas fameux d’Aaron Feueurstein) retenus pas certains auteurs à propos des réponses éthiques (fondées sur les vertus) à des crises majeures (« Approaches to ethics for corporate crisis management », Journal of Business Ethics, 87, 2009, p. 109-116).
(9) Je simplifie largement les conceptions issues de Margaret Gilbert (« Modelling collective belief », Synthese, 73(1), 1987, p. 185-204) et de T. Ryan Byerly et Meghan Byerly.
(10) P. Sandin, « Collective military virtues », Journal of Military Ethics, 6(4), p. 303-314, 2007.
(11) Per Sandin reprend la distinction de Peter French entre collectivité agrégée (aggregate collectivity) et collectivité agglomérée (conglomerate collectivity). Une collectivité agrégée est un simple rassemblement de personnes (par exemple des personnes qui se trouvent là après un accident de la circulation) ; son identité n’est que l’agrégation des identités des personnes concernées (P. A. French, Collective and corporate responsibility, Columbia University Press, 1984).
(12) Passage issu de ma thèse Dilemmes éthiques en entreprise : le rôle de la faiblesse de la volonté dans la décision des cadres (2003).
(13) « Collective military virtues », op. cit.
(14) Sandin propose une troisième observation, d’ordre pragmatique, mais elle manque de clarté. Il semble noter que l’attribution de vertus à une organisation peut favoriser le développement des vertus chez ses membres, dans la mesure où « les propriétés des entreprises influencent le comportement et les croyances des individus ».