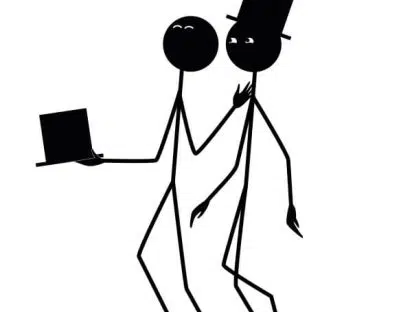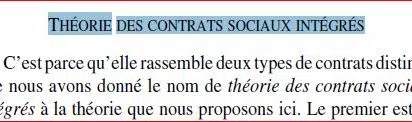Un débat – dont le destin est peut-être éphémère – s’est ouvert depuis fin mai 2018 à propos de l’inscription dans la Constitution française de l’idée de bien commun. Son point de départ est une tribune publiée dans Le Monde du 29 mai 2018 : « Bien commun : “Une réforme sage et mesurée de notre Constitution est devenue une urgence” ». Comme l’indique le chapeau de l’article, « cinquante juristes, économistes et chercheurs [ont] appelé à subordonner juridiquement, dans la Constitution, la défense de la liberté d’entreprendre et de la propriété privée à la défense de l’intérêt général ». Une réponse critique, signée par quinze intellectuels, a été publiée dans le même quotidien le 19 juin, avec pour titre : « On commence par le “bien commun” et on finit par le Comité de salut public ». L’opposition tranchée entre les deux perspectives révèle l’importance qu’a prise aujourd’hui la notion de bien commun, ainsi que des notions associées comme celle de « biens publics mondiaux ». Cependant elle mérite un (modeste) éclaircissement, qui fait l’objet du présent billet.
L’éclaircissement en question concerne la définition du bien commun. En vérité, il n’est pas défini conceptuellement, mais en extension, c’est-à-dire par l’énumération des éléments qui le constituent. Cette définition extensionnelle se trouve dans la tribune du 29 mai, à propos, selon ses termes, de « notre incapacité à légiférer pleinement » du fait du caractère inviolable du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Le bien commun comprend notamment l’absence de « travail des enfants dans les manufactures du bout du monde », la souveraineté alimentaire, la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique ou l’absence de tout « privilège des puissants à se soustraire à l’impôt », lequel est un aspect de la « distribution inégale des droits et devoirs » qui prévaut au sein des sociétés humaines et entre sociétés humaines. Ce dernier élément dénote le fait que le bien commun devrait constituer, du fait de son inscription souhaitable à l’article 34 de la Constitution, un obstacle aux « puissances privées » dont les intérêts peuvent nuire à l’intérêt général. En ce sens, il joue en quelque sorte un rôle protecteur ou négatif.
Le bien commun n’étant pas défini en fonction de son contenu conceptuel, on comprend que les auteurs de la réponse du 15 juin 2018 aient pu affirmer que « ce “bien commun” est assez flou pour se prêter aisément à tous les détournements politiques ». Point intéressant, le bien commun y est également abordé de façon négative puisque, dans le cadre de la « vision holistique de la société » qui serait défendue par les tenants de la tribune du 29 mai, il s’opposerait aux « projets et modes de vie individuels, par nature égoïstes ».
C’est ici qu’un éclaircissement s’avère utile. Il peut être exprimé de la façon suivante : si les auteurs de la tribune du 29 mai ne définissent pas conceptuellement, ou de façon substantielle, la notion de bien commun, c’est parce qu’il n’est pas utile de le définir conceptuellement. Une raison majeure provient des désaccords relatifs à cette notion. Même des définitions apparemment voisines peuvent dénoter des conceptions d’arrière-plan, philosophiques et religieuses, tout à fait divergentes sur la définition et le contenu du bien commun.
Cela signifie-t-il que les auteurs de la réponse 15 juin 2018 avaient raison d’insister sur son caractère « flou » ? Non, car il faut distinguer ce qui relève des conceptions d’arrière-plan ou des visions du monde de ce qui relève des croyances pratiques, qui sont directement reliées à l’action. Exprimons cette distinction dans le langage de Jacques Maritain, penseur catholique qui contribua à l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et fut aussi l’auteur d’un essai sur le bien commun (1).
Dans un discours prononcé en 1947 à l’UNESCO, Maritain séparait la pensée spéculative et la pensée pratique. Il affirmait ainsi que, du fait de la division des esprits dans le monde moderne, « l’accord peut se faire non pas sur une commune pensée spéculative, mais sur une commune pensée pratique, non pas sur l’affirmation d’une même conception du monde, de l’homme et de la connaissance, mais sur l’affirmation d’un même ensemble de convictions dirigeant l’action ». Ainsi, s’agissant de la « charte démocratique » et du respect des droits de l’homme, peu importe que les citoyens partagent les mêmes justifications théoriques. Ce qui importe, c’est qu’ils puissent « formuler ensemble de communs principes d’action ».
Si l’on applique cette distinction au débat relatif à la suggestion d’intégrer le bien commun au sein de la Constitution, on comprend pourquoi les auteurs de la tribune du 29 mai aient préféré limiter leur définition de ce concept à une énumération de questions et d’enjeux, plutôt que d’en proposer une définition théorique.
Les répondants du 15 juin 2018 le savaient, mais ils se sont contentés de dénoncer le caractère flou et potentiellement totalitaire du bien commun. Ils auraient pu ajouter une critique supplémentaire : le fait que, dès lors que le bien commun – il vaudrait mieux dire : un bien commun – est institutionnalisé (c’est-à-dire inscrit dans la loi), il peut conduire à exacerber les conceptions d’arrière-plan qui le justifient. Ainsi, ceux qui parvenaient à des « communes pensées pratiques » et à des « communs principes d’action » pourraient être conduits à camper sur leurs positions, à mettre en avant de façon irrévocable leurs propres conceptions du bien commun. Il en résulterait des conflits relatifs à différentes conceptions du bien au sein de la société, des conflits si intenses (car se référant à des convictions profondes) qu’ils pourraient remettre en cause des principes fondamentaux de la démocratie libérale.
Alain Anquetil
(1) J. Maritain, La personne et le bien commun, Paris, Desclée de Brouwer, 1947,
[cite]