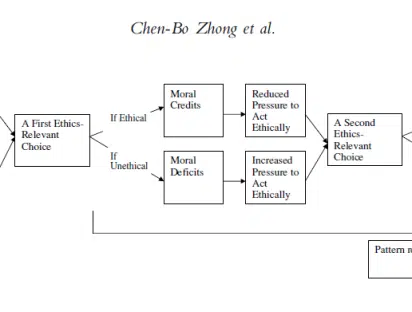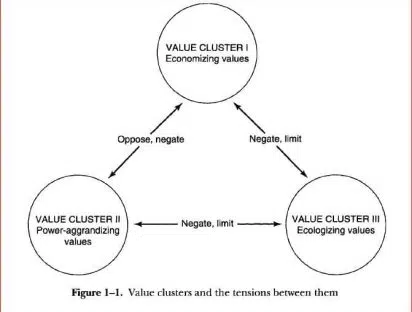La distinction entre bad apple et bad barrel, qui a été discutée dans l’article précédent, trouve un écho dans le scandale qui touche la FIFA (Fédération internationale de football association) depuis quelques années, en particulier depuis l’arrestation en juin 2015 par la Suisse, à la demande des autorités américaines, de plusieurs de ses cadres en raison de soupçons de corruption (1). L’affaire est revenue il y a peu dans l’actualité à l’occasion de l’élection de son nouveau président le 26 février dernier (2). Dans un article de mai 2015 où la FIFA était assimilée à une mafia par un conseiller de son ancien président, Sepp Blatter, on pouvait lire : « Depuis quarante ans et l’intronisation de Havelange [président de la Fédération de 1974 à 1998], la FIFA a la culture de la corruption. Blatter ne l’a pas initiée, mais il a toujours toléré la corruption. C’est un moyen de rester au pouvoir. » (3) On notera également que, selon les termes d’un article publié sur le site Bloombergview.com, les États-Unis ont justifié leur incrimination par un texte de loi plutôt réservé aux organisations criminelles, le RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act de 1970), qui prévoit de lourdes sanctions civiles et pénales (4). Le blog Global Anticorruption met de son côté en exergue « l’environnement qui a permis à la FIFA d’éviter, pendant très longtemps, d’avoir à rendre des comptes sur ses défaillances éthiques » (5). Il estime que « la FIFA a été en mesure de s’instituer quasi État souverain, un État lié (voire non lié) seulement par ses propres règles plutôt que par celles des communautés et des pays dans lesquels il opère ». Ces éléments suggèrent que ce qui est reproché à la FIFA n’est pas le fait de quelques individus (des « apples »), mais de l’organisation en tant que telle (le « barrel »). Une notion vient à l’esprit pour qualifier ce genre de cas : celle de gouvernance, souvent mentionnée par les observateurs (6). Elle constitue le sujet d’étude d’un spécialiste de sciences politiques, Roger Pielke, qui a appliqué différents types de mécanismes formels de gouvernance à la FIFA (7). Mais avant de décrire son analyse, ce qui sera l’objet du prochain billet, il est utile de dire un mot des auteurs dont il s’est inspiré à propos de l’obligation de rendre compte, traduction du mot anglais accountability.
Ces auteurs sont Ruth Grant, philosophe et professeur en sciences politiques, et Robert Keohane, spécialiste d’affaires internationales. Dans un article publié en 2005, ils ont proposé plusieurs types de mécanismes permettant à des organisations internationales, par exemple des ONG telles que la FIFA, de rendre compte de leurs activités dans un contexte de mondialisation (8) – ces mécanismes ayant été directement repris par Pielke. Leurs deux questions de recherche étaient les suivantes : « Comment penser l’obligation de rendre compte à l’échelle globale en l’absence d’une démocratie globale ? » et « Qui sont ceux qui demandent des comptes, à qui demandent-ils des comptes, et selon quels critères ? » (9).
Sur l’accountability, Grant et Keohane précisent qu’à l’inverse de mécanismes de contrôle, par exemple d’équilibre des pouvoirs s’agissant d’institutions politiques, l’obligation de rendre compte opère après les faits. Il s’agit, pour une organisation, d’informer sur ses activités afin de permettre de les appréhender et, le cas échéant, de prononcer des sanctions. Naturellement, les mécanismes d’accountability produisent également des effets ex ante dans la mesure où ils jouent un rôle de dissuasion. Grant et Keohane décrivent ensuite la fonction de l’accountability. Selon leurs termes, elle vise à « révéler et sanctionner deux sortes d’abus : d’une part, l’exercice du pouvoir sans autorisation ni légitimité ; d’autre part, des décisions qui sont jugées, par ceux auxquels l’organisation doit rendre des comptes, imprudents ou injustes ». Enfin, ils proposent une définition de l’accountability, qu’ils empruntent à Ronald Oakerson : « Devoir rendre des comptes signifie que l’on doit répondre de son action ou de son inaction et, selon la réponse apportée, que l’on s’expose à des sanctions potentielles, négatives ou positives » (10). Grant et Keohane ajoutent que les conditions de l’obligation de rendre compte ne se limitent pas à l’information communiquée par l’organisation et aux sanctions qu’elle encourt :
« L’information et les sanctions sont des conditions nécessaires mais non suffisantes de l’accountability. Elles présupposent des normes de légitimité qui établissent non seulement les critères grâce auxquels il est possible d’évaluer l’exercice du pouvoir, mais aussi quelles personnes sont autorisées à exercer le pouvoir et qui est en droit de leur demander des comptes. »
Les auteurs proposent ensuite deux modèles théoriques de l’accountability, dont la différence a surtout trait aux personnes auxquelles l’organisation doit rendre compte : l’un est fondé sur l’idée de participation – les destinataires de l’accountability sont alors « ceux qui sont affectés pas ses actions »,– l’autre sur un principe de délégation – les responsables de l’organisation doivent rendre des comptes à ceux qui leur ont confié des pouvoirs d’action.
Après une discussion sur les critères de légitimité (que nous n’aborderons pas ici, bien que la suite de l’article en dépende partiellement), Grant et Keohane proposent « sept mécanismes distincts relatifs à l’obligation de rendre compte », qui s’appliquent, à des degrés divers, « aux États, aux ONG, aux organisations multilatérales [par exemple le FMI et la Banque Mondiale], aux entreprises multinationales et aux réseaux transgouvernementaux (11) ». Les quatre premiers (mécanismes d’accountability hiérarchique, de surveillance, financière et légale) correspondent plutôt au modèle de la délégation, les trois autres (mécanismes d’accountability par rapport au marché, aux pairs et à la réputation) au modèle de la participation (12). Grant et Keohane en donnent une description succincte accompagnée d’exemples.
L’obligation de rendre des comptes de nature hiérarchique, typique des organisations bureaucratiques, favorise la communication d’informations entre les différents niveaux de pouvoir à l’intérieur de ces organisations.
Le mécanisme de surveillance concerne les relations entre organisations selon le modèle « principal – agent ». Par exemple, la Banque Mondiale est l’agent des États et peut, à ce titre, faire l’objet de contrôles.
L’accountability financière a trait au droit des organismes de financement d’obtenir des informations des entités auxquelles ils versent des fonds.
Le mécanisme d’accountability de type légal concerne, selon les mots de Grant et Keohane, « l’exigence que les agents respectent des règles formelles et soient en mesure de justifier leurs actions, en se référant à ces règles, devant des tribunaux ou des instances quasi-judiciaires.
Le mécanisme par rapport au marché, que les auteurs jugent important quoique moins familier lorsque l’on parle d’accountability, a trait à l’influence qu’exercent investisseurs et consommateurs sur les agents, influence qui passe par le marché. Le retrait d’investisseurs d’un pays trop risqué ou le boycott de consommateurs sont deux exemples d’un défaut de ce type d’accountability.
Les mécanismes relatifs à l’obligation de rendre compte aux pairs naissent des relations entre organisations n’ayant pas entre elles de relations de mandat ou de domination. Ils sont propres aux situations de coopération, dont la qualité de l’information véhiculée par les participants est un ingrédient essentiel.
Enfin, le mécanisme fondé sur la réputation publique est adossé aux six autres. Comme l’indiquent les auteurs, « les supérieurs hiérarchiques, les organismes de surveillance, les tribunaux, les chiens de garde en matière financière, les marchés et les pairs prennent tous en compte la réputation des agents ».
Grant et Keohane concluent sur une discussion relative à la manière dont ces mécanismes contraignent, en pratique, les organisations. On comprend, après lecture, que leur catégorisation remplit un double objectif : décrire une réalité complexe pour mieux la saisir et identifier des dispositifs et des processus organisationnels ou relationnels plus ou moins spécialisés dont la finalité est de favoriser la transparence. Quelle que soit l’appréciation que l’on puisse porter sur la typologie de Grant et Keohane, on comprend que Pielke ait eu besoin de recourir à une grille d’analyse de ce genre pour évaluer la gouvernance de la FIFA. Nous en parlerons dans le prochain billet.
Alain Anquetil
(1) Voir le documentaire « La planète FIFA » sur Arte et les articles suivants : « Corruption à la FIFA: chronologie d’un scandale en 19 dates » (L’Équipe, 25 février 2016), « Des hauts responsables de la FIFA arrêtés à Zurich » (L’Équipe, 27 mai 2015), et « Ce que l’on sait du scandale qui éclabousse la FIFA » (Le Monde, 28 mai 2015).
(2) Cf. « FIFA : L’élection d’Infantino, une victoire pour les États-Unis » (Eurosport, 1er mars 2016) et « As FIFA eyes reform, corruption probes continue » (The Washington Post, 25 février 2016).
(3) « La FIFA est une mafia » (Le Monde, 27 mai 2015). Voir aussi « La justice américaine dénonce la culture de la « corruption » à la FIFA », publié par le même journal le même jour.
(4) Voir « U.S. Treats FIFA Like the Mafia », 27 mai 2015.
(5) « FIFA’s Faustian Bargain: Corruption for the Cup? » (The Global Anticorruption Blog, 21 novembre 2014).
(6) Le mot est fréquemment cité à propos de la FIFA (par exemple : « Corruption in FIFA? Its auditors saw none », The New York Times, 5 juin 2015 et « Trois propositions pour améliorer la gouvernance de la FIFA », Les Cahiers du Football, juin 2015), mais, dans une interview accordée au Monde en juin 2015, Philippe Piat, président de la FIFpro, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, n’évoquait pas seulement des questions de gouvernance : « Ce scandale de corruption va permettre de faire ouvrir les yeux à tout le monde pour montrer qu’il n’y a pas que ce problème de gouvernance. Le foot est une zone de non-droit. On l’a vu avec le système de tierce propriété [propriété de joueurs par des tiers], que l’on dénonçait et qui a finalement été interdit. On le voit aujourd’hui avec le montant faramineux des transferts, avec le contrat des joueurs qui signent dans un club fin juin et qui sont vendus dans un autre début juillet ; ou encore, avec les conflits d’intérêts dans les instances. » (« Philippe Piat (FIFpro) : ‘Le football est une zone de non-droit’ » (Le Monde, 4 juin 2015).
(7) R. Pielke, « How can FIFA be held accountable? », Sport Management Review, 16, 2013, p. 255-267.
(8) R. W. Grant et R. O. Keohane, « Accountability and abuses of power in world politics », The American Political Science Review, 99(1), 2005, p. 29-43.
(9) Je traduis l’anglais global par « global », même si le mot auquel il est fait référence peut être celui de « mondialisation ». Sur la différence entre « globalisation » et « mondialisation », voir H. Dumez et A. Jeunemaître, « Comprendre la globalisation », La Gazette de la société et des techniques, 4, 2000.
(10) R. J. Oakerson, « Governance Structures for Enhancing Accountability and Responsiveness », in J.L. Perry (éd.) Handbook of Public Administration, Jossey-Bass Publishers, 1989.
(11) Selon le site Cooperinterci, « les réseaux transgouvernementaux mettent en contact des agences publiques de différents Etats dans le cadre non pas d’un traité ou d’une organisation multilatérale, mais de clubs d’interactions pour prendre en charge des problèmes de régulation ayant une portée internationale et engageant les intérêts des Etats. »
(12) En anglais : hierarchical, supervisory, fiscal, legal, market, peer, public reputational accountability.