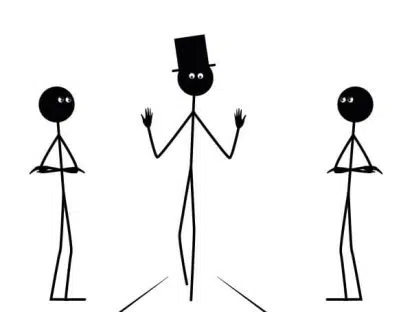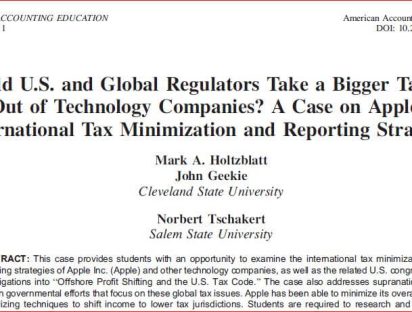Il était surprenant d’entendre, dans une émission de France Culture portant, entre autres, sur les stratégies d’influence de certaines entreprises multinationales (1), des mots et expressions qui conviennent plutôt au contexte politique d’une dictature : « danger physique », « danger psychologique », « danger juridique », « museler [les] défenseurs des droits de l’homme [et] la société civile », « intimidation systématique quel que soit votre statut », « autocensure », ou encore : « différentes stratégies qui, ensemble, forment un système, une forme de harcèlement moral ». Dans le même ordre d’idées, il était également question des « procédures-bâillons », c’est-à-dire des « poursuites stratégiques contre la mobilisation publique » engagées par certaines entreprises contre des individus ou des groupes qui s’opposent à elles (2).
Certains propos relatifs à la manière de s’opposer à ces stratégies d’influence auraient également pu être tenus dans un contexte politique autoritaire. En voici deux exemples. Le premier fait référence au respect des droits de l’homme et à la vision supposée dominante en matière économique et légale :
« La difficulté, c’est qu’aujourd’hui on nous a convaincus (parce que le droit est un outil de persuasion) que le droit commercial et le droit des entreprises était supérieur aux droits de l’homme. Et c’est ce paradigme qu’il faut changer si on veut pouvoir créer un système plus respectueux des droits de l’homme. » (3)
Le second propos concerne les liens entre la sphère politique et la sphère économique, des liens qui peuvent conduire des acteurs politiques à occuper des rôles économiques et inversement :
« Cette imbrication-là est un instrument d’influence particulièrement important des multinationales sur les autorités publiques, et cela permet aussi de générer une production de la norme qui est aujourd’hui plutôt favorable aux entreprises. » (3)
On est loin de l’esprit du capitalisme qui, selon la sociologue Eve Chiapello, devrait conduire ses acteurs à rechercher la légitimité sociale de leur pouvoir et de leurs actions : « la revendication de légitimité […] caractérise l’esprit du capitalisme », affirme-t-elle (4). Cette recherche de justification va nécessairement au-delà des intérêts matériels que défendent ces acteurs. Elle va d’autant plus loin aujourd’hui que l’organisation de l’économie met en péril la planète et ceux qui y vivent. L’adhésion des entreprises au mouvement de la RSE peut ainsi être comprise comme un aspect de leur revendication de légitimité. Elles tendent, selon les mots d’Eve Chiapello, à « incorporer dans les justifications du capitalisme les valeurs sociales ou environnementales au nom desquelles il est critiqué ».
Les invités de l’émission de France Culture ne s’inscrivaient pas dans ce cadre. Le mouvement de la RSE ne faisait pas partie des moyens qu’ils envisageaient pour lutter contre le pouvoir de certaines entreprises multinationales. Ils prônaient plutôt la mobilisation de la société civile, des modifications du droit (pour éviter par exemple les poursuites-bâillons) et le recours des citoyens à la justice. Ajoutons des moyens qui n’ont pas été explicitement évoqués dans le contexte de l’émission, mais qui sont certainement compatibles avec leur position : mouvements consuméristes, consommation collaborative (5), modes d’échange portés par l’économie solidaire (6), boycotts, « réseaux [qui] remettent en cause le système libéral et la consommation de masse » (7), avènement d’une nouvelle société inspirée notamment par l’écologie politique (8).
Quoiqu’il en soit de ces moyens, on reste surpris par l’apparente analogie entre les effets pratiques des stratégies d’influences de certaines firmes multinationales et ceux des régimes politiques totalitaires. En effet, le but de ces firmes ne relève pas de la politique. Elles n’ont pas pour mission de maintenir un régime ou une idéologie politique, mais, pour l’essentiel, de défendre des intérêts matériels. Il est vrai, cependant, que ces intérêts possèdent leur propre logique : « Que les intérêts matériels s’installent une bonne fois, et ils imposeront fatalement les seules conditions dans lesquelles ils peuvent continuer à exister », écrivait Joseph Conrad (9). Or, ces conditions sont aussi de nature politique.
L’analogie surprend aussi en raison d’un aspect essentiel de la crise écologique et de la crise sociale. S’agissant de la première, les données scientifiques recueillies ont aujourd’hui la valeur d’un avertissement global, pour reprendre le titre (et jeu de mots) d’un récent article de Libération (10). Autrement dit, « l’avertissement est écrit sur le mur », comme l’écrivait l’historien René Grousset en 1946 à la suite des horreurs de la deuxième guerre mondiale et du péril nucléaire (11). Dans ce contexte, comment certains acteurs économiques peuvent-ils ignorer délibérément « l’avertissement qui est écrit sur le mur », étant entendu que cet avertissement s’adresse également à eux, et notamment à leurs intérêts matériels ?
Enfin, l’analogie surprend pour une troisième raison. Si elle a quelque vérité, alors les stratégies d’opposition ou de résistance devraient, elles aussi, s’inspirer de celles qui ont été mises en œuvre – et qui sont mises en œuvre – par des opposants à des régimes politiques totalitaires. Nous traiterons de cette hypothèse singulière dans le prochain billet.
Alain Anquetil
(1) Une émission de la série « Culture Monde » du mercredi 19 septembre 2018 sur les « nouvelles figures héroïques ».
(2) Ou des « actions en justice, de nature stratégique, visant à interdire la participation du public », selon leur définition traduite littéralement de l’anglais : « Strategic lawsuit against public participation » ou « SLAPP ». Voir le site Wikipedia.
(3) Ces propos ont été tenus par deux invités de l’émission citée à la note 1.
(4) E. Chiapello, « Esprit du capitalisme », in N. Postel et R. Sobel (dir.), Dictionnaire critique de la RSE (p. 182-187), Presses universitaires du Septentrion, 2013.
(5) Sur la consommation collaborative, voir A. Slim et M. Prieto, Idées reçues sur l’économie collaborative, Le Cavalier Bleu Editions, 2018 ; V. Peugeot et al., « Partager pour mieux consommer ? Enquête sur la consommation collaborative », Esprit, 7, 2015, p. 19-29 ; et I. Dabadie et P. Robert-Demontrond, « Posséder autrement : une approche socio-anthropologique de la consommation collaborative », Management & Avenir, 88(6), 2016, p. 131-153.
(6) Voir P. Frémeaux, « L’économie sociale et solidaire, virage ou mirage ? », Le journal de l’école de Paris du management, 94(2), p. 21-28, et, à propos d’un exemple propre à l’économie solidaire : J. Lagane, « Du teikei à l’AMAP, un modèle acculturé », Développement durable et territoires, 2(2), 2011.
(7) Expression que j’emprunte au site de l’Institut National de la Consommation.
(8) Voir par exemple Sylvie Ollitrault, Militer pour la planète : Sociologie des écologistes, Presses universitaires de Rennes, 2008.
(9) Cf. mon article du 14 mai 2018 : « Réforme de l’objet social des entreprises (2) : les intérêts matériels ».
(10) Voir « Réchauffement climatique, le global warning », Libération, 28 août 2018.
(11) R. Grousset, Bilan de l’histoire, Paris, Plon, 1949. Il s’inspirait de mots écrits sur le plâtre du mur du palais du roi Balthazar, fils de Nabuchononosor, par une mystérieuse main humaine (La Bible, Daniel, 5,1-28).
[cite]