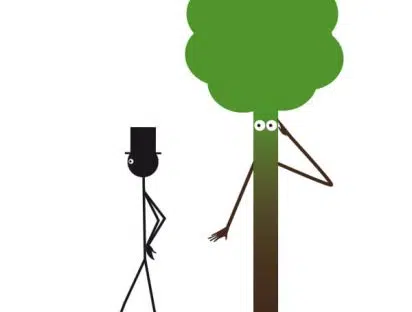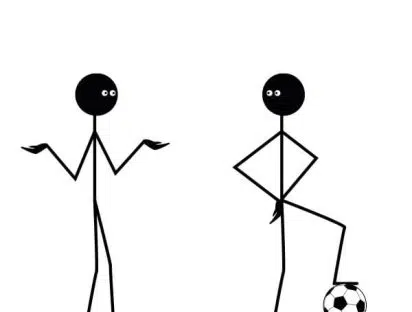Le concept de « transgression » semble pouvoir s’appliquer à plusieurs personnages caractéristiques du domaine économique. Peut-être le premier des transgresseurs (au sens ordinaire du terme, qui ne correspond pas au sens holiste discuté dans l’article précédent) serait-il le fraudeur puisqu’il enfreint la loi et les règles éthiques. Certains entrepreneurs qui sont allés contre les usages en faisant preuve d’un altruisme allant à l’encontre de la rationalité économique pourraient aussi appartenir à cette catégorie. Le lanceur d’alerte (whistleblower) est un autre personnage potentiellement transgressif. C’est à lui que s’intéresse le présent article. Le rapport du lanceur d’alerte avec la transgression sera abordé à travers les observations d’un philosophe américain, C. Fred Alford.
Une recherche sur la présence du mot transgression dans les titres des articles publiés par les trois principales revues d’éthique des affaires (Journal of Business Ethics, Business Ethics Quarterly, Business Ethics : A European Review) ne donne que deux résultats – deux articles du Journal of Business Ethics. Encore ces deux articles ne portent-ils que sur la manière de restaurer la confiance après une « transgression éthique ». Ainsi l’article d’Andranik Tumasjan, Maria Strobel et Isabell Welpe s’intéresse-t-il aux conséquences d’une transgression morale d’un dirigeant d’entreprise sur les rapports entre direction et employés. Cependant, le concept central y est celui de distance sociale entre le dirigeant et le personnel, non celui de transgression en tant que tel (1). Par ailleurs, aucun des deux articles n’aborde le cas du lanceur d’alerte, qui est l’objet du présent billet.
Un lien entre le concept de transgression et ce personnage de la vie des entreprises a été établi par le philosophe politique C. Fred Alford dans un ouvrage paru en 2001 (2). Il est utile de faire une remarque introductive avant de présenter le contexte dans lequel il évoque, à plusieurs reprises, le concept de « transgression ».
Dans la mesure où le lanceur d’alerte agit en vue du bien public, son acte n’est transgressif qu’à l’égard d’une norme, disons, de loyauté, dont la finalité est de garantir la cohésion du groupe, en l’occurrence la communauté humaine que constitue l’entreprise. C’est en fonction du bien public (mais sans se référer à la loyauté) qu’Alford définit le lanceur d’alerte « en théorie » : « Quiconque s’exprimant au nom du bien public au sein d’une entreprise est un lanceur d’alerte » (3). Et plus loin : « Le lanceur d’alerte est un acteur politique dans un monde apolitique. Ce monde s’appelle l’entreprise. » En revanche, le fraudeur, ou l’auteur d’une « transgression éthique », pour reprendre les termes des auteurs cités précédemment, agit contrairement au bien public.
Le lanceur d’alerte, lui, ne transgresse pas les règles générales inflexibles qui servent l’utilité publique, selon des mots empruntés à David Hume (4). Pourtant Alford emploie l’image de la transgression comme « dépassement des limites » pour qualifier le personnage du lanceur d’alerte : « Dans un tel monde [je souligne], l’idée la plus terrifiante est que les représentants du dehors se trouvent à l’intérieur, qu’ils sont des traîtres parmi nous (traitors in our midst). Le lanceur d’alerte devient l’incarnation d’une maladie sournoise, un violeur de frontière (boundary violator). » Ce personnage est un transgresseur, mais seulement au sein d’un certain monde, non au sein du monde plus large de la société civile qu’il vise à défendre. C’est un monde de ce genre qui était visé par les observations de Jean-Yves Le Naour, rapportées dans l’article précédent (« À quoi s’applique la transgression ? »), en matière de solidarité professionnelle entre médecins.
Mais comment Alford caractérise-t-il ce monde ? Il affirme que « l’entreprise est une bureaucratie obsédée par ses frontières » et qu’elle « agit comme si elle vivait dans un monde hobbesien parfait : son but est l’autarcie, et celle-ci est réalisée grâce à la transgression. L’entreprise ne protège ses frontières qu’en violant (transgressing) celles des autres pour éviter que ses propres frontières ne soient violées. » Les membres d’une telle organisation font l’expérience de pratiques situées dans un environnement hostile composé d’autres entreprises ».
On retrouve, à travers cette image de l’entreprise, l’une des métaphores de la vie des affaires que trois spécialistes du champ, Andrew Wicks, Daniel Gilbert et Edward Freeman, proposaient de modifier dans un fameux article. Il s’agissait de la première d’une série de cinq métaphores auxquelles de nouvelles devraient être substituées afin de donner de nouveaux fondements à l’éthique dans les affaires. On notera, dans la citation qui suit, le lien que ces trois auteurs établissent entre l’idée de « frontière », qui est associée au concept de transgression, et le mythe de la frontière spécifique à l’esprit américain : « Le premier présupposé est l’idée que l’entreprise est une entité autonome naturellement séparée de son environnement. […] L’un des thèmes caractéristiques de l’expérience américaine est l’image du pionnier qui décrit à la fois un individu héroïque et un contexte dans lequel cet individu est capable d’agir et de dominer un environnement hostile. Pour prendre tout son sens, cette conception s’appuie sur la notion de frontière – l’endroit où les actions d’une personne ont peu de relations et peu d’influence directe sur ceux qui ne font pas partie de son clan (ou de son entreprise). » (5) Le langage d’Alford est de même nature mais plus direct, puisqu’il affirme que « pour lutter contre la paranoïa organisationnelle [provenant du fait que les membres des entreprises sont aussi des citoyens], la préférence va à l’autarcie organisationnelle. Elle implique un contrôle total sur l’environnement interne afin de lutter contre les menaces provenant de l’environnement externe. »
Selon Alford, il résulte de cette conception de l’organisation que « l’idée que le lanceur d’alerte défend la vérité contre la loyauté est une idée trompeuse. Elle suggère que l’entreprise est trop passive et trop statique », alors qu’elle lutte en réalité pour défendre en quelque sorte son intégrité territoriale. « La véritable opposition », poursuit Alford, « se trouve entre une transgression individuelle et une transgression collective. L’individu est-il prêt ou non à participer à la transgression collective ? »
Alford invoque Michel Foucault pour caractériser la manière dont fonctionne le pouvoir au sein de l’entreprise (ce pouvoir a selon lui un caractère féodal et particulier : il ne s’agit pas d’un pouvoir purement bureaucratique, mais d’un pouvoir féodal, propriété de seigneurs, de vassaux et d’arrière-vassaux, sans contrôle de la bureaucratie). Si un employé devient un lanceur d’alerte, il fait l’expérience de la discipline au sens où Foucault l’entend. Il est considéré comme un malade au sein de sa propre organisation : « Le pouvoir, au sein de l’entreprise, opère de manière plus intime et plus subtile [que la simple capacité de l’employeur de licencier le lanceur d’alerte] : il isole de ses collègues celui qui fait preuve d’insubordination en le diagnostiquant comme une personne anormale ou perturbée. […] Le pouvoir disciplinaire fait du lanceur d’alerte un patient, bien que ce terme doive être compris dans son sens le plus large, à savoir une personne dont les perceptions défectueuses de la réalité proviennent d’une maladie morale ou émotionnelle, et que le pouvoir doit corriger pour éviter que ses symptômes ne s’avèrent contagieux. » C’est ici qu’Alford explique sa formule : « Le lanceur d’alerte est un acteur politique dans un monde apolitique ». En effet, « dans un régime de discipline, il n’y a pas de place pour un discours politique ou éthique. Le seul type de dialogue qui puisse s’instaurer avec le patient est strictement instrumental. Son objectif est de contrôler le patient grâce à des mécanismes de catégorisation et d’étiquetage ».
Selon le point de vue d’Alford, le lanceur d’alerte ne fait pas l’expérience de sa déloyauté envers l’entreprise, mais de sa confrontation avec un système humain tourné vers la défense de son intégrité, c’est-à-dire, pour reprendre le langage de la transgression, de ses frontières (6). Le concept de loyauté n’est pas essentiel pour expliquer la situation psychologique du lanceur d’alerte ou juger de son acte. C’est un point qu’un spécialiste de l’éthique des affaires, Ronald Duska, a développé de façon systématique dans un court et brillant argument. Il en sera question dans le prochain article.
Alain Anquetil
(1) A. Tumasjan, M. Strobel et I. Welpe, « Ethical leadership évaluations after moral transgression: Social distance makes the difference », Journal of Business Ethics, 99, 2011, p. 609-622. L’autre article est de P.T.M. Desmet, D. De Cremer et E. van Dijk, « On the psychology of financial compensations to restore fairness transgressions: When intentions determine value », Journal of Business Ethics, 95, 2010, p. 105-115.
(2) C. F. Alford, Whistleblowers: Broken lives and organizational power, Cornell University Press, 2001.
(3) En pratique, Alford définit le lanceur d’alerte par son expérience des représailles dont il est la victime (p. 18). Il a fondé ses analyses sur des entretiens avec des lanceurs d’alerte dont l’une des caractéristiques est d’avoir souffert de leurs actes dans leurs vies personnelles. « La plupart ont perdu leurs maisons », écrit Alford. « Beaucoup ont perdu leurs familles. Cela n’arrive pas d’un seul coup, mais le dossier des lanceurs d’alerte traîne pendant des années, ce qui exerce une pression considérable sur les familles. La plupart des lanceurs d’alerte souffrent de dépression et d’alcoolisme (…) » etc.
(4) David Hume, Appendice III de l’Enquête sur les principes de la morale.
(5) A.C. Wicks, D.R. Gilbert, R.E. Freeman, « A feminist reinterpretation of the stakeholder concept », Business Ethics Quarterly, 4(4), 1994, p. 475-497 ; tr. fr. C. Laugier, « Une réinterprétation féministe du concept de partie prenante », in A. Anquetil (éd.), Textes clés de l’éthique des affaires, Paris, Vrin, 2011.
(6) Alford emploie le concept de transgression comme synonyme de « violation de frontière ».