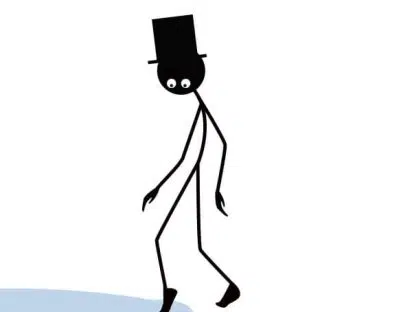Le Président de la République a annoncé mi-janvier un « Pacte de responsabilité entre l’État et les entreprises » . Ses objectifs sont de favoriser la compétitivité, l’investissement et l’emploi grâce à un allègement du coût du travail, une diminution de certaines taxes, une simplification administrative. Des contreparties sont en outre attendues des entreprises – c’est le « quatrième chantier » du projet. Dans la mesure où le dispositif en appelle à la responsabilité de tous (le projet a pour nom « pacte de responsabilité »), le concept bien connu de « responsabilité sociétale de l’entreprise » (RSE) semble pouvoir être invoqué pour justifier les « contreparties » exigées par les pouvoirs publics. À la lumière de la RSE, conçue dans le cadre d’un échange contractuel, cette demande de contreparties ressemblerait même à une platitude ou à un truisme. Ce truisme aurait la forme « Etre socialement responsable implique d’assumer des responsabilités envers la société », ou encore cette forme plus générale : « En contrepartie de A, on souhaite obtenir B ». Si tel est le cas – si la référence à des contreparties exprime un truisme,– il s’agit d’un truisme intelligent.
1.
Il est utile de rappeler au préalable certains éléments de la déclaration sur le Pacte de responsabilité faite par le Premier Ministre le 30 janvier 2014 à l’issue des entretiens avec les partenaires sociaux :
« Nous considérons que des engagements concrets doivent être pris au nom des entreprises, en contrepartie des efforts que va consentir la collectivité nationale pour favoriser leur compétitivité et financer les allègements par des réductions de la dépense publique. Sur ce point, concernant les contreparties, le dialogue social doit être au cœur de la démarche. (…) Le renforcement du dialogue social, et en premier lieu, dans chaque entreprise, c’est la première des contreparties. Il faut absolument le renforcer. Parmi ces contreparties, trois objectifs ont été présentés par le président de la République : les créations d’emplois, la qualité des emplois et l’investissement en France. Ces contreparties doivent être définies au niveau national interprofessionnel, en termes de méthodes, en termes de règles du jeu, pour y parvenir, et ensuite, déclinées au niveau des branches professionnelles. Elles devront également faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation au travers d’un observatoire des contreparties, où siègeront l’État, les organisations patronales et syndicales. »
Les critiques à l’encontre du Pacte de responsabilité ont porté sur le caractère contraignant des contreparties (les syndicats ont demandé des contreparties chiffrées, cf. l’article du Nouvel Observateur « Coût du travail : l’ultimatum de Ayrault sur les contreparties »), sur la capacité à les identifier et à les mesurer, sur la façon dont le mot « contrepartie » a été utilisé (voir la remarque d’Éric Le Boucher dans Les Echos : « La question des contreparties, posée ainsi, ne peut que provoquer des déceptions et réenvenimer le combat social que François Hollande cherche à apaiser. Ce qui devrait être en jeu, ce ne sont pas des chiffres mais une conversion parallèle, celle du patronat, à la social-démocratie à l’allemande ») et sur la création d’un « Observatoire des contreparties » (cf. cet avertissement de The Economist : « Mr Hollande promet par exemple un Observatoire des contreparties pour vérifier que les entreprises respectent leur part du travail et créent des emplois, ce qui a un air orwellien et paraît infaisable »).
2.
Soit dit en passant, on notera que le mot « contrepartie » prend ici un sens différent d’une « opinion qui s’oppose à une autre et la complète ». Il doit plutôt être compris comme dénotant deux éléments : d’abord les termes d’un contrat entre les entreprises et les pouvoirs publics, ensuite l’idée d’un équilibre entre les droits et les devoirs réciproques des entreprises et de la société. Cette acceptation renvoie presque naturellement au concept de responsabilité sociétale de l’entreprise, si naturellement que la question des contreparties semble exprimer un truisme de la forme : « Etre socialement responsable implique d’assumer des responsabilités envers la société ». Quel que soit le contenu normatif que l’on associe au concept de RSE, il a une qualité contractuelle et il accorde un poids particulier au concept d’« équilibre », un concept central de la théorie des parties prenantes, souvent associée à la RSE. L’abondante littérature sur la RSE est riche de références aux rôles respectifs de l’État et des entreprises. L’ouvrage de Keith Davis et Robert Blomstrom sur les relations entre Business, Society et Environment, publié en 1971, décrit fort bien la question (1). On y retrouve l’idée d’un équilibre entre deux perspectives : celle de la vie économique marchande dont l’idéal est la doctrine du laissez-faire et « qui veut profiter des avantages procurés par l’État sans que celui-ci n’interfère » ; celle de l’intérêt général où l’accent est mis sur l’éthique sociale et les avantages procurés par l’existence d’un Etat fort. Les auteurs affirment qu’aucune de ces perspectives ne doit être réfutée. Ce qui importe, disent-ils, « c’est que les entreprises et l’État se mettent d’accord sur la nature du système socioéconomique » voulu par les citoyens. Et plus loin ils consacrent successivement une section au « rôle de l’État » et une autre au « rôle des entreprises », comme s’ils décrivaient les termes d’un contrat. Le propos de Davis et Blomstrom est de même nature que celui d’Adolf Berle quelques années auparavant. Berle affirmait qu’il existe un contrat implicite et explicite entre les entreprises et l’Etat. Il soulignait par exemple, dans un passage où figure le mot « contrepartie » : « Bien sûr, les entreprises doivent faire des profits – sinon elles seraient hors course. Mais leur profit doit avoir la nature d’une compensation équitable au titre du travail qu’elles réalisent, et non d’une prime provenant de l’exploitation du consommateur. (…) Chaque chef d’entreprise sait quand il obtient un prix décent ou équitable (…). Lui et ses collègues devraient comprendre que tôt ou tard l’intervention légitime de l’État sera la contrepartie de l’abus du pouvoir sur les prix, et qu’elle signifiera très vraisemblablement leur propre sortie de la scène. » (2)
3.
Ces considérations invitent à penser qu’exiger des contreparties, comme le fait le « Pacte de responsabilité », n’est que l’expression de la responsabilité des entreprises envers la société. Si les pouvoirs publics favorisent la compétitivité des entreprises, c’est pour qu’il en résulte un bénéfice du point de vue de l’intérêt général. L’exigence de contreparties va de soi. En parler revient à faire un truisme, à exprimer une banalité, une « vérité d’évidence », comme le dit le dictionnaire Le Robert. Le mot « truisme » a une connotation péjorative. Ainsi le Vocabulaire philosophique Lalande souligne qu’un truisme est une « proposition qui ne mérite pas d’être énoncée, parce qu’elle est trop évidente, ou même inutilement tautologique ». Cependant, un truisme (ou une tautologie, les deux termes n’étant pas identiques) mérite parfois d’être dit. On le trouve affirmé dans les dictionnaires eux-mêmes, par exemple dans cette définition donnée par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales qui, après avoir rappelé à nouveau qu’un truisme est une « vérité trop évidente pour devoir être énoncée », propose une citation soulignant son intérêt : « Pour que nous puissions connaître un secteur du passé, (…) il faut encore qu’il se rencontre un historien capable de les repérer et surtout de les comprendre. Cela pourrait passer pour un truisme, mais l’expérience montre que le rappel d’une telle évidence n’est peut-être pas inutile (Marrou, Connaiss. hist., 1954, p. 102) ».
4.
Revenons au Pacte de responsabilité. Une première forme de truisme, exprimée par la question des contreparties, a été évoquée : « Etre socialement responsable implique d’assumer des responsabilités envers la société ». On peut envisager une autre forme, plus générale et valant expressément dans le contexte d’un échange : « En contrepartie de A, on souhaite obtenir B ». Si ces deux truismes ont été activés dans le cadre du débat sur les contreparties, c’est, on peut le penser, parce qu’ils remplissent une fonction. Comme le souligne l’historien Henri Irénée Marrou, rappeler un truisme « n’est peut-être pas inutile ». Mais de quelle fonction s’agit-il ? On peut avancer deux réponses. D’abord un truisme permet d’actualiser une vérité parfois oubliée – ici celle selon laquelle une entreprise est une construction juridique (même si elle n’est pas que cela), qu’elle a des responsabilités envers la société, qu’elle a conclu avec elle un contrat implicite et explicite, etc. Ensuite, du fait de sa forme générale, un truisme ne désigne pas des personnes particulières. Il est incomplet. Par exemple, la forme « En contrepartie de A, on souhaite obtenir B » comprend quatre places manquantes : la personne ou l’entité qui reçoit A, celle qui donne B (la contrepartie), celle qui occupe le « on » et celle qui bénéficie de la contrepartie. Sa forme logique est : « Si [place 1] fournit A à [place 2], alors [place 3] devrait fournir B à [place 4] en contrepartie ». C’est sur cette question que s’articule la controverse actuelle sur les contreparties (voir à titre d’illustration cet article du Figaro.fr publié le 13 février : « Pacte de responsabilité : Pierre Gattaz fait machine arrière »). Plus précisément, sur l’identification de la personne ou l’entité particulière qui est censée donner des contreparties. Pour le gouvernement, ce sont les entreprises qui doivent apporter des contreparties. Pour les sceptiques ou les opposants, c’est le marché qui apportera « naturellement » des contreparties. Ce qui, en termes d’imputation de responsabilité, représente une différence significative. Alain Anquetil (1) K. Davis et R.L. Blomstrom, Business, society, and environment: Social power and social response, McGraw Hill, 1971. (2) A.A. Berle, « A new look at management responsibility »,Management of Personnel Quarterly, 1(3), 1962, p. 2-5. Cité dans A. Anquetil, Qu’est-ce que l’éthique des affaires ?, Paris, Vrin, « Chemins Philosophiques », 2008.