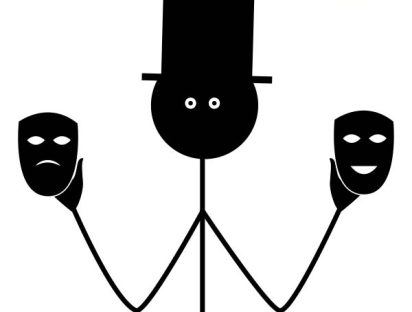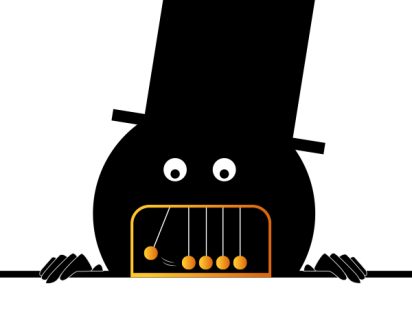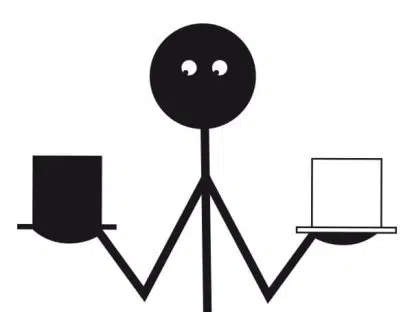Dans une étude (non publiée à ce jour) demandée par l’Autorité de la concurrence, dont les résultats généraux ont été révélés par Libération, il apparaît que le citoyen, en tant que consommateur, évalue très positivement la concurrence, alors que le même citoyen, en tant que salarié, est beaucoup plus mesuré. Par exemple, 82% des répondants estiment que la concurrence donne « plus de choix » et 76% qu’elle permet d’obtenir de « meilleurs prix », mais seulement 38% considèrent qu’elle a un effet positif sur l’emploi. Cette divergence de perspectives n’a rien de surprenant. Elle renvoie à un clivage supposé entre le citoyen et le consommateur qui serait propre aux sociétés démocratiques à économies de marché. Ce clivage intéresse aussi l’éthique des affaires, en particulier sa théorie dominante, la théorie des parties prenantes. Certains des arguments qui y ont été proposés permettent d’éclairer un peu les rapports entre la perspective du citoyen et celle du consommateur.
Le clivage entre le citoyen et le consommateur est souvent confondu avec une dichotomie entre les valeurs démocratiques et les valeurs consuméristes. Une telle analogie permet de situer l’analyse à un niveau très général. Ainsi, dans la préface à l’édition française de Supercapitalism, publié en 2007, Robert Reich décrit un conflit « entre le supercapitalisme et la démocratie » (1). Ce conflit, écrit-il, « est, par essence, un conflit entre deux visions de l’humanité. La première voit les personnes comme essentiellement individualistes, voire égoïstes, privilégiant les acquisitions matérielles ; la seconde comme essentiellement des êtres sociaux, tournés vers les autres, plus préoccupés de satisfaction psychologique et spirituelle que de bien-être matériel ». Reich ajoute que « le capitalisme répond de mieux en mieux à nos désirs en tant qu’acheteurs individuels de biens et services, et la démocratie de moins en moins bien à nos attentes collectives en tant que citoyens ». Il souligne enfin que, « depuis plusieurs décennies, nous assistons à une modification de l’équilibre du pouvoir à notre détriment, en tant que citoyens, mais à notre avantage, en tant que consommateurs et investisseurs ».
Reich suggère que la séparation citoyen / consommateur a des racines profondes car elle trouve son origine dans des « visions de l’humanité » et des croyances sur le monde. Dans le même ordre d’idées, le sociologue Jörn Lamla remarque que la séparation entre citoyen et consommateur correspond à la division, particulièrement forte, entre sphère publique et sphère privée (2). Il en résulte selon lui que la notion de « citoyen consommateur » (consumer citizen) est hybride et instable.
Cette instabilité, et plus largement les rapports entre les perspectives du citoyen et du consommateur, ont été envisagés au sein de l’éthique des affaires académique. Il est utile de rendre compte de quelques-uns des arguments avancés, spécialement de ceux qui concernent le statut du consommateur au sein de la théorie des parties prenantes.
Schématiquement, la théorie des parties prenantes postule que toute firme doit s’attacher à satisfaire et à équilibrer autant que possible les intérêts des entités avec lesquelles elle est en relation. L’identification des personnes ou groupes de personnes qui comptent comme « parties prenantes » est en soi une question théorique et empirique, mais il est d’usage de considérer que les actionnaires, les employés, les fournisseurs, les collectivités publiques et, bien sûr, les clients (les consommateurs) sont à première vue des parties prenantes.
Dans un article paru en 2005, James Fitchett, chercheur en management, souligne cependant la difficulté à considérer les consommateurs comme d’authentiques parties prenantes (3). Bien sûr, les consommateurs ont des intérêts à faire valoir auprès des entreprises dont ils achètent les produits. Ces intérêts portent notamment sur leur qualité et leur sécurité. Mais la diversité et l’éparpillement des consommateurs, ainsi que leur manque d’organisation et de moyens de représentation, en font des entités particulières. En outre, Fitchett considère que la coopération est un ingrédient essentiel des relations entre la firme et les entités qui composent son environnement – et un ingrédient essentiel de la théorie des parties prenantes.
La coopération suppose la reconnaissance mutuelle que l’autre est une fin en soi dont les revendications ou intérêts à notre égard sont légitimes. S’agissant spécifiquement des relations entre l’entreprise et ses clients, cela signifie que chaque partie reconnaît que l’autre a des intérêts à défendre et que ces intérêts doivent être satisfaits parce qu’ils ont une valeur en eux-mêmes.
Or, selon Fitchett, les consommateurs n’envisagent pas que leurs relations avec les firmes sont de nature coopérative. Il affirme d’abord que le consommateur croit que les entreprises le considèrent comme un simple moyen et non comme une fin. Il est même incapable, dit Fitchett, « de croire que les entreprises […] ne s’intéressent pas seulement à lui en tant que moyen de faire du chiffre d’affaires ». Mais surtout, et peut-être par symétrie, les consommateurs, de leur côté, considèrent très probablement que les firmes sont de simples moyens d’atteindre leurs fins. Ainsi, « [ils] ne croient pas avoir, envers les firmes [dont ils achètent les produits], quelque devoir de sollicitude ou quelque responsabilité que ce soit. Les consommateurs croient qu’ils ont le droit de choisir parmi des offres concurrentes sans prendre en compte les conséquences possibles pour les différentes firmes en compétition ni, d’ailleurs, pour les autres parties prenantes affectées par leurs actions ». Ils cherchent uniquement à satisfaire leurs besoins égoïstes. De ce fait, ils ne représentent personne d’autre qu’eux-mêmes et « n’ont aucune responsabilité morale en-dehors de la satisfaction de leurs propres besoins et désirs ». Fitchett ajoute que les consommateurs acceptent de fait que les conditions qui règlent leurs transactions avec les firmes soient implicitement « prédéterminées et non négociables ». Autrement dit, ils adoptent un point de vue passif qui exclut toute perspective de coopération avec les firmes.
Steve Fleetwood, spécialiste des relations sociales, propose un argument complémentaire (4). Selon lui, le consommateur des pays riches perd de vue le fait que ses achats de biens et services ont des conséquences sur d’autres parties prenantes. Par exemple, l’achat de produits à très bas prix peut contribuer à entretenir de la main d’œuvre rémunérée à des salaires dérisoires dans des pays pauvres ou émergents. Si le consommateur le tolère, c’est parce que son point de vue (de consommateur) est dissocié de sa perspective de citoyen. Pour Fleetwood, cette dissociation ne vient pas du fait que le consommateur n’est pas directement responsable de la fixation des salaires dans les pays où sont produits les biens à bas prix. Elle est due au « discours hégémonique [qui] encourage les consommateurs à voir les biens qui sont à des prix relativement bas comme de « bonnes affaires » plutôt que comme le résultat des faibles salaires payés à d’autres personnes ». Ce « discours hégémonique » consumériste encourage même les consommateurs à considérer que leur liberté de choisir ce qui est le plus avantageux pour eux-mêmes est un « droit naturel » plutôt que le résultat de conditions sociales déplorables pour d’autres gens. Il les « dissuade de voir les effets nuisibles de leur activité de consommation sur la condition sociale des employés ».
Ces considérations se réfèrent fondamentalement aux perspectives des personnes, c’est-à-dire à leurs visions et à leurs croyances sur le monde. L’idée générale est qu’une même personne peut entretenir des perspectives différentes en tant que consommateur et en tant que citoyen, comme si elle jouait des rôles cloisonnés. Toutefois, on peut considérer qu’un tel état de choses viole le principe de rationalité selon lequel tout individu devrait rechercher « une cohérence en termes de valeurs et de comportement dans ses différents domaines d’activité » (Fitchett). Un tel principe conduit à affirmer que si, en tant que citoyen, on peut faire des choix éclairés prenant en compte le bien public (donc une pluralité de parties prenantes), alors on devrait exercer la même capacité de choix dans tous les autres domaines, y compris celui de la consommation. La perspective de Fleetwood revient à dire que ce principe de cohérence est en quelque sorte neutralisé par le « discours hégémonique consumériste », alors que Fitchett considère de son côté que le consommateur se cantonne dans une attitude passive, très différente de son attitude active de citoyen, parce que ses croyances le placent dans un rapport non coopératif avec les firmes.
Comment comprendre, à la lumière de ces éléments, les résultats généraux issus de la récente étude de l’Autorité de la concurrence ? La façon dont ils ont été présentés semble renvoyer à la dissociation de perspectives qui a été évoquée précédemment. Mais ces résultats semblent aussi rapprocher les deux perspectives puisque les mêmes répondants soulignent les avantages et les inconvénients de la concurrence dans différentes domaines de la vie sociale. Après tout, Libération évoque le « citoyen-consommateur » et le « citoyen-salarié », ce qui est une manière d’unir les perspectives ou de montrer que le principe de cohérence n’est finalement pas « neutralisé ».
Alain Anquetil
(1) R.B. Reich, Supercapitalism: The transformation of business, democracy, and everyday life, New York, Alfred A. Knopf, 2007, tr. fr. M.-F. Pavillet, Supercapitalisme. Le choc entre le système économique émergent et la démocratie, Paris, Vuibert, 2008.
(2) J. Lamla, « Consumer citizen: The constitution of consumer democracy in sociological perspective », German Policy Studies ,4(1), 2008, p. 131-166.
(3) J.A. Fitchett, « Consumers as stakeholders: prospects for democracy in marketing theory », Business Ethics: A European Review, 14(1), 2005, p. 14-27.
(4) S. Fleetwood, « Workers and their alter egos as consumers », Capital & Class, 94, 2008, p. 31-48.