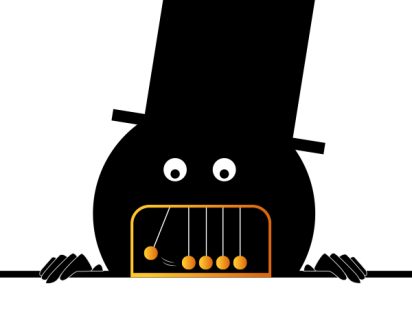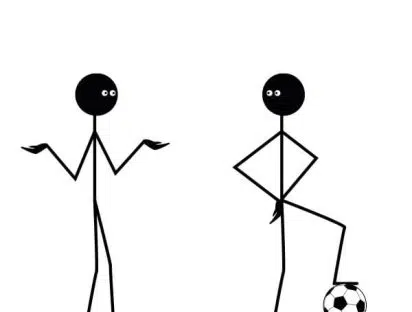Si l’on parcourt les titres des travaux d’éthique des affaires publiés depuis une dizaine d’années, on notera certainement l’intérêt qui est porté à des biens moraux que le sens commun juge essentiels à toute existence humaine. L’amitié et la sagesse en sont des exemples. Il y aurait de quoi s’en étonner en raison du contexte si particulier de la vie des affaires, caractérisé, entre autres, par la compétition, la recherche continue de la performance et l’exigence d’efficacité. Mais l’étonnement ferait long feu. Car l’intégration de tels biens moraux dans les réflexions sur l’éthique des affaires a un sens. Avant d’aborder, dans de prochains articles, certains aspects de ces biens particuliers, je voudrais commencer par une remarque sur la manière dont l’un d’eux, la sagesse, est mis en scène dans l’éthique des affaires.
On se souvient que, dans le précédent billet, King terminait son propos sur la sagesse de deux personnages imaginaires, aux convictions divergentes, dialoguant de l’avenir de l’industrie nucléaire. Au cours de leur entretien, « ils réaliseraient que leurs différences sont moins significatives et moins profondes que tout ce qu’ils possèdent en commun, et que ce sens commun représente le commencement de la sagesse » (1). Et King suggérait que ce bien, qui est aussi une vertu, doit permettre d’« empêcher notre monde de devenir un lieu démesurément instable ».
Ce qui mérite d’être souligné ici, c’est l’hypothèse qu’il existe une qualité du caractère, en l’occurrence la sagesse, susceptible de corriger certains maux de l’existence humaine et de réaliser des valeurs fondamentales (le sens commun et le langage semblent aussi attester de sa réalité). De la même façon, Moberg et Seabright ont soutenu, à propos de l’imagination morale – considérée par beaucoup d’auteurs comme l’une des composantes de la sagesse –, qu’elle permet de corriger le fait que « les organisations exercent une influence potentiellement corruptrice, que de mauvaises organisations peuvent conduire de bonnes personnes à faire de mauvaises choses » (2). En bref, la sagesse (dans le premier cas) et l’imagination morale (dans le second) sont les moyens de réparer des états de choses négatifs – les divergences des deux personnages de King et l’influence corruptrice des organisations selon Moberg et Seabright.
Il s’agit là, me semble-t-il, d’une forme d’« argument transcendantal », c’est-à-dire d’un type d’argument où une certaine chose X « est une condition nécessaire de possibilité d’un (fait) Y, sachant que, dès lors que Y existe, il s’ensuit logiquement que X doit également exister » (3).
Par exemple, dans le cas qui nous occupe, X est l’absence de sagesse ou l’un de ses contraires (comme l’ignorance, la folie ou l’absurdité, que j’emprunte au dictionnaire Robert), Y désignant certains types de maux dont la réalité est considérée comme incontestable. L’argument ressemble à un argument transcendantal parce que l’on considère que le défaut de sagesse est ce qui rend possible ces maux. Il est naturellement aisé de faire un pas de plus et de conclure que la sagesse doit être recherchée afin d’y remédier. Pour résumer, on doit accepter que la « sagesse » existe puisqu’elle est une condition nécessaire de la réalisation de certains biens humains. Et dès lors qu’elle existe, elle peut être un objet d’étude.
Face à ce type d’argument (qui a par ailleurs été très discuté en philosophie), et en simplifiant à l’extrême, deux voies sont possibles. La première est d’accepter l’argument et de centrer l’analyse sur les composantes de la sagesse. En éthique des affaires, beaucoup d’auteurs ont retenu cette approche.
La deuxième est de mettre en question la prémisse de l’argument, celle selon laquelle il existe des maux entravant la réalisation de biens humains et que l’exercice de la sagesse peut précisément corriger. Quels sont ces maux ? Se tromper de problème ou « parvenir trop tôt à des conclusions », dit King. Être prisonnier de certains schémas mentaux, disent par exemple Moberg et Seabright. Nul doute que ces « maux » existent. Mais le point important est qu’ils doivent être reliés à la sagesse (ou plutôt à un défaut de sagesse) sans présupposer que la sagesse explique le fait qu’ils se manifestent. Présupposer qu’un défaut de sagesse explique que l’on se soit trompé dans la définition d’un problème et conclure que la solution à cet état de choses aurait été de faire preuve de sagesse n’est pas un argument satisfaisant.
Alain Anquetil
(1) King, J.B., « Learning to solve the right problems: The case of nuclear power in America », Journal of Business Ethics, 12, 1993, p. 105-116.
(2) Moberg, D. J. et Seabright, M. A., « The development of moral imagination », Business Ethics Quarterly, 10(4), 2000, p. 845-884.
(3) Stern, R., « Transcendental Arguments », The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/transcendental-arguments/>.