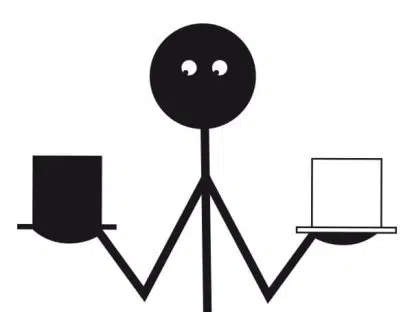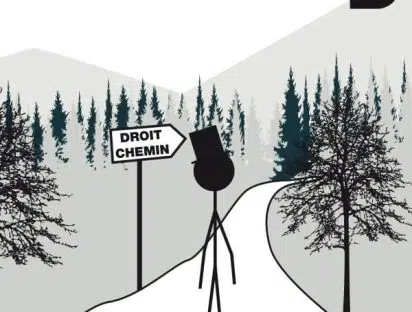Des faits de corruption qui touchent le Brésil, on a tiré différentes sortes de conclusions. Il n’est guère surprenant que les plus fréquentes soient de nature politique et économique puisque figurent, parmi les faits en question, des réseaux de relations, inconnus du grand public, impliquant des décideurs politiques et des décideurs économiques. D’autres observations ont été faites, par exemple sur l’ampleur de la corruption (1), sur le déclin du rêve brésilien de compter parmi les nations les plus influentes du monde (2), sur l’identité du dignitaire qui ouvrira les prochains jeux olympiques à Rio (3), sur les méthodes du juge Sergio Moro (dont fait partie la « délation récompensée » inspirée de l’opération Mains propres en Italie, comme l’indique Le Temps du 21 mars 2016), qui a acquis une stature de héros (4), ou encore sur les peines prononcées à l’encontre de dirigeants d’entreprises, dont Marcelo Odebrecht, condamné début mars à plus de19 ans de prison (5). Mais ces observations sont anecdotiques sur le plan de l’analyse causale. Il faut dire que celle-ci est plutôt ardue. L’analyste ou l’observateur avisé doivent éviter le danger de la simplification, qui les conduirait par exemple à retenir seulement, pour éclairer la situation, (i) le concept général de corruption, (ii) l’idée que des faits singuliers sont à son origine, (iii) l’hypothèse que le système politico-économique brésilien est la source principale des dérèglements ou (iv) que des faits sociaux, que l’on qualifierait de « culturels », doivent être privilégiés dans toute recherche d’explication. L’analyste ou l’observateur devraient plutôt considérer chacun de ces niveaux d’analyse. Je les développe dans le présent billet. (i) Cette phrase, tirée d’un article du Courrier International du 20 mars 2016, témoigne d’une explication fondée sur le seul concept de corruption : « [Dilma Rousseff et son prédécesseur Lula] se retrouvent pris dans ce qui ressemble, de l’extérieur, à un scandale de corruption d’envergure : le détournement présumé de milliards de dollars appartenant à Petrobras, l’entreprise pétrolière contrôlée par l’Etat » (je mets les italiques). Il faut dire que, d’une part, une partie de l’affaire repose sur un pacte de corruption classique (« an old-fashioned kickback scheme », selon les mots du New York Times) fondé sur un cartel d’entreprises ayant pour client Petrobras, et que, d’autre part, dans le cas d’espèce, les faits impliquant des hommes politiques tombent également sous le concept général de corruption. Cependant, la corruption est, me semble-t-il, considérée comme l’un des aspects de la crise actuelle. Dans la Revue des Deux Mondes, Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS, soulignait ainsi l’interdépendance entre la corruption et d’autres dimensions de la vie brésilienne : « le vote [des députés brésiliens, le 17 avril 2016, en faveur de destitution de la présidente Dilma Rousseff, qui a, soit dit en passant, été annulé le 9 mai 2016 sur décision du le président de la chambre basse du parlement] marque […] l’emballement d’un système dont une grande partie de celles et ceux qui le composent sont visés, signalés, accusés dans un système de corruption généralisé ». (ii) La seconde ligne d’analyse repose sur l’idée que le scandale que connaît le Brésil est le résultat de motivations et de conduites individuelles. Il s’agit d’une explication psychologique qui n’empêche pas d’envisager que des agents économiques et politiques aient profité d’opportunités issues de failles dans le système politique et judiciaire brésilien. « Ambition, cupidité, vanité, hubris [démesure] » sont les quatre premiers mots d’un article du Financial Times publié le 16 avril 2016. S’ils s’appliquent, dans cet article, à la sphère politique, ils pourraient aussi bien s’appliquer à la sphère économique. Lorsque le New York Times écrit que, « selon les procureurs, les entreprises [qui travaillaient pour Petrobras] ont arrêté de se faire concurrence et ont décidé de collaborer » et ainsi de « former une entente [en vue de] décider à l’avance laquelle d’entre elles remporterait un contrat donné » (le vainqueur facturant à un prix plus élevé que s’il y avait eu compétition sur un marché libre), ce avec des complices travaillant chez Petrobras, il fait référence à des délibérations et des actions d’individus singuliers. (iii) Le troisième type d’explication repose sur la notion de système. À propos du juge Moro, on lit dans un article publié sur le site autresbresil.net que, « promu au rang de héros national, le juge de Curitiba a contribué à mettre à jour le gigantesque système de corruption institutionnalisé depuis des lustres, entre grandes entreprises et pouvoir politique […] » (« Dans le Brésil du juge Moro », par Kakie Roubaud, 31 mars 2016). Mais l’idée de système comme facteur explicatif peut aller au-delà de la référence à une organisation de personnes tenues par des liens déterminant, à un degré important, leurs actions. Évoquer un « système de corruption généralisée », comme l’a fait un juge brésilien, c’est évoquer plus largement l’organisation économique et politique du Brésil. Interviewé par L’Humanité le 27 avril 2016, le sociologue Glauber Sezerino notait qu’au Brésil, « le financement électoral est privé. Les entreprises et groupes économiques injectent des milliards d’euros aussi bien dans les campagnes des candidats du Parti des travailleurs (PT) au gouvernement que dans celles de l’opposition. Une entreprise ne donne pas, elle fait un investissement sur l’avenir pour avoir des contrats une fois le gouvernement et le Parlement élus, car la place de l’État dans l’économie est très importante. Cela crée un mécanisme d’interconnexion entre les sphères économiques, privées et politiques où la corruption va de soi. » Le mot « système » est employé par différents commentateurs. Par exemple, Christophe Ventura affirme que « nous sommes dans ce que je décris comme une séquence d’auto-cannibalisation du système politique, un système qui essaie de sauver sa peau avec des retournements très opportunistes ». De son côté, Bernardo Sorj, professeur à l’Institut des hautes études de l’université de São Paulo, notait en 2014 que « le nationalisme brésilien, la fierté nationale s’expriment à travers l’identification à des expressions de la société comme le sport ou les arts, tandis que l’organisation sociale et politique évoque traditionnellement des sentiments négatifs ». Il ajoutait qu’« une grande partie des manifestants de juin 2013 [leur action était fondée sur un mécontentement sans rapport avec l’affaire Petrobras, qui n’avait pas encore éclaté] ne sont ni pour ni contre le gouvernement. Ils veulent simplement un pays meilleur et se méfient d’un système politique associé à la corruption et à l’impunité. » (iv) Le quatrième niveau d’analyse s’intéresse aux spécificités de la société brésilienne. L’explication repose sur le concept de fait social, qui se démarque notamment d’un fait psychologique. Il n’est pas inutile de rappeler la manière dont Émile Durkheim le définissait. Selon Durkheim, les faits sociaux « consistent en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui ». Il proposait plusieurs exemples, dont faisaient partie les pratiques commerciales :
« Le système de signes dont je me sers pour exprimer ma pensée, le système de monnaies que j’emploie pour payer mes dettes, les instruments de crédit que j’utilise dans mes relations commerciales, les pratiques suivies dans ma profession, etc., etc., fonctionnent indépendamment des usages que j’en fais. Qu’on prenne les uns après les autres tous les membres dont est composée la société, ce qui précède pourra être répété à propos de chacun d’eux. Voilà donc des manières d’agir, de penser et de sentir qui présentent cette remarquable propriété qu’elles existent en dehors des consciences individuelles. » (7)
Il y a, dans tout fait social, une dimension « impérative » et « coercitive » plus ou moins forte. Le fait social s’impose à nous. Sa contrainte est notamment perceptible lorsque nous tentons d’y résister. Même lorsqu’elle est indirecte, elle s’exerce sur celui qui cherche à s’y opposer, tel cet industriel dont Durkheim prend l’exemple :
« Industriel, rien ne m’interdit de travailler avec des procédés et des méthodes de l’autre siècle ; mais, si je le fais, je me ruinerai à coup sûr. Alors même que, en fait, je puis m’affranchir de ces règles et les violer avec succès, ce n’est jamais sans être obligé de lutter contre elles. Quand même elles sont finalement vaincues, elles font suffisamment sentir leur puissance contraignante par la résistance qu’elles opposent. » (8)
Certains articles font référence à des faits sociaux à propos du scandale de corruption au Brésil. Par exemple, Marilza de Melo Foucher écrit sur son blog que « membres de l’appareil judiciaire » brésilien et médias auraient dû « comprendre le virus de la corruption et pourquoi elle reste ancrée dans la culture d’un mode de vie (« o jeitinho ») brésilien (« Le Brésil résistera-t-il aux tentatives de coups d’État ? », blog de Mediapart, 6 avril 2016). Un personnage fait également partie de cette « culture » : le « doleiro ». Selon Kakie Roubaud, il est « un personnage clef de l’économie brésilienne », précisant qu’« il échange, entre autres, des montagnes de dollars au marché noir, ce qui est totalement illégal mais absolument courant. » (Je mets les italiques.) Cité dans l’article du New York Times, un avocat déclarait : « C’était comme si nous avions su, au Brésil, que la corruption est un monstre. Mais nous n’avions jamais réellement vu le monstre. Ce qui s’est passé, c’était comme voir le monstre. » À quoi se référait-il exactement ? Au concept de corruption ? À la constitution psychologique de certains individus ? Au système politique et économique brésilien ? Ou à des faits sociaux tels que le jeitinho ? Sans doute le monstre a-t-il de multiples identités. La quatrième est sans doute la plus intéressante et la plus troublante. Nous en parlerons dans un prochain billet. Alain Anquetil (1) Un article du New York Times du 7 août 2015 (« Petrobras Oil Scandal Leaves Brazilians Lamenting a Lost Dream », par David Segal) indique que le montant des pots-de-vin s’élèvent à environ 3 milliards de dollars, ajoutant avec humour que, sur ce plan, l’affaire surpasse celle de la FIFA : «Petrobras officials have pegged the total of all bribes at nearly $3 billion, a figure that makes the scandal at FIFA, world soccer’s governing body, seem like the work of amateurs ». (2) Le même article rappelait les propos du président Lula à cet égard : « In the last decade, Brazil seemed to be on the verge of the kind of sustainable economic boom that its leaders had predicted for years. Ms. Rousseff’s predecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, had boldly predicted Brazil would rise to greatness in the 21st century, a forecast that seemed entirely plausible when, in 2010, the country’s economy expanded at the rate of 7.5 percent, its greatest performance in 24 years. Brazil, along with China, India and Russia, was regarded as among the world’s most promising emerging markets. » (3) Voir « Les JO de Rio éclaboussés par les crises à répétition du Brésil ? », Eurosport, 26 avril 2016. (4) Cf. « Sergio Moro, le juge qui “extermine les corrompus” » (Courrier International, 22 août 2015), « Sergio Moro, le juge qui fait trembler le monde politique brésilien » (Le Temps, 21 mars 2016) et « La campagne musclée du juge Moro contre Lula » (Libération, 31 mars 2016) (5) « Affaire Petrobras: Marcelo Odebrecht condamné à 19 ans de prison » (RFI, mars 2016). (6) B. Sorj, « La politique brésilienne dans une nouvelle ère ? », Socio [En ligne], 3 | 2014, mis en ligne le 25 octobre 2014, consulté le 09 mai 2016. (7) E. Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1937 / 1993. (8) Ibid.