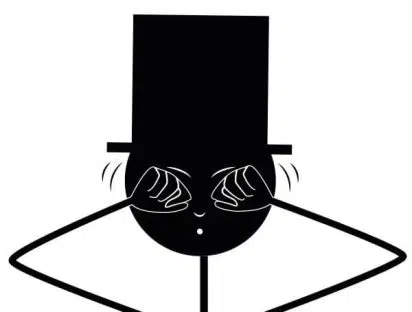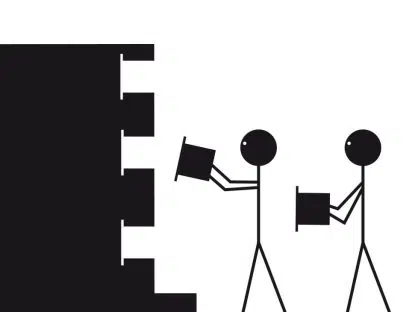Tenir un collectif pour responsable d’une action morale ou immorale et, à ce titre, l’encenser ou le blâmer, sont des pratiques courantes (dans ce qui suit, le cas où un dirigeant ou un salarié commet des actions nuisibles pour son propre compte, par exemple un détournement de fonds, ne sera pas pris en considération). Ainsi, le philosophe David Cooper considérait comme une « évidence » le fait qu’« une responsabilité soit imputée aux collectifs aussi bien qu’aux individus » – des phrases comme « L’Allemagne est responsable de la deuxième guerre mondiale » ou « Le club porte la responsabilité de sa relégation » en témoignent (1). On peut aussi citer Larry May, déjà mentionné dans le précédent billet : « Il est d’usage courant de parler des profits excessifs de Mobil Oil ou des actions de bienfaisance de la Fondation Ford » (2). On remarquera que les jugements de louange ou de blâme visant des groupes humains ne concernent pas seulement des actions. Ils portent aussi sur le fait que tel groupe possède ou non des caractéristiques particulières, par exemple des valeurs et des principes d’action. Une organisation caritative a plus de chances d’être évaluée positivement qu’une organisation terroriste, même si les évaluateurs ignorent la nature des actions accomplies par l’une ou l’autre – et ignorent si elles en ont accompli.
Bien que l’usage langagier consistant à personnifier les groupes humains, par exemple en leur imputant des responsabilités, réponde en partie à un principe de parcimonie des locuteurs (il est plus « économique » de se contenter de citer Mobil Oil ou la Fondation Ford que de faire une paraphrase du genre : « Les responsables X du département Y de la société de droit américain Mobil Oil ont accompli, dans le cadre d’une procédure de délégation de pouvoir approuvée le…, etc. »), il peut aussi révéler les attitudes profondes que tout individu peut avoir envers n’importe quel groupe humain. On peut tenter de proposer trois arguments pour examiner en quoi le fait d’imputer la responsabilité de quelque chose à un groupe peut être expliqué par des attitudes de ce genre ou, pour le dire autrement, par des « causes psychologiques ».
Le premier argument repose sur le fait empirique que les activités des groupes humains – ou parfois, comme le soulignait l’exemple des organisations caritatives ou terroristes, les valeurs qu’ils incarnent – suscitent des émotions. Or, si une personne éprouve des émotions à cause d’un groupe humain, il paraît approprié qu’elle lui attribue directement une responsabilité en tant que groupe. Cet argument est par exemple évoqué par Marion Smiley, philosophe spécialisée en éthique, dans l’article « Collective responsibility » de l’encyclopédie philosophique de l’université de Stanford. Se référant à la philosophe Deborah Tollefsen, Smiley affirme en effet que « le simple fait que nous ayons des réactions émotionnelles envers des groupes – colère, ressentiment et indignation morale – justifie la pratique consistant à leur imputer une responsabilité morale. Il en est de même du simple fait que nous éprouvions des sentiments de fierté, de culpabilité et de honte en tant que membres de groupes. »
Le deuxième argument expliquant la pratique consistant à imputer une responsabilité à un groupe porte essentiellement sur les grandes organisations, celles qui disposent de plans stratégiques, de procédures de délégations de pouvoir et de dispositifs formels organisant la coopération interne. Plus précisément, la cause psychologique conduisant ici à imputer une responsabilité aux groupes est le caractère formel et impersonnel de leur fonctionnement. Cette cause repose sur une préconception de l’entreprise comme « organisation formelle » dont les membres (dirigeants et employés) sont des opérateurs visant uniquement la réalisation de ses buts. Comme le disait John Boatright, spécialiste de l’éthique des affaires, à propos de ce type de perspective : « Une entreprise est un ensemble hiérarchiquement organisé de rôles, chacun d’entre eux comprenant des ensembles bien définis de droits et de responsabilités, ceux-ci étant à leur tour déterminés principalement par les buts de l’organisation, et en particulier par ce qui constitue le moyen le plus efficace de réaliser ces buts : l’idéal de rationalité. (…) Dans une organisation formelle, toute personne remplit un rôle défini de façon fonctionnelle et agit pour le compte de son organisation ». En bref, selon cet argument, le mécanisme psychologique consistant à imputer une responsabilité à des groupes en tant que groupes proviendrait de leur caractère formel et impersonnel – le caractère « impersonnel » signifiant que, les relations au sein du groupe étant formellement codifiées, il ne sert à rien de tenir pour responsable l’un des membres du groupe. (On notera que ce propos pourrait être prolongé par une perspective évolutionnaire reposant sur l’idée que le sens moral dont sont dotés les êtres humains ne parviendrait pas, dans le contexte de l’attribution de responsabilités morales, à saisir le fonctionnement des organisations perçues comme formelles et impersonnelles.)
Le troisième argument repose sur le fait que les groupes humains, spécialement les grandes entreprises, prennent des engagements publics en tant que groupes. Les chartes éthiques, codes de conduite ou déclarations du même ordre sont des engagements de cette nature. Dans le monde de l’entreprise, les expressions « Nos engagements » et « Nos valeurs » sont monnaie courante. L’argument n’est pas ici que, dès lors que des collectifs s’expriment publiquement à la première personne du pluriel, alors c’est à eux, en tant que collectifs, qu’il convient d’imputer la responsabilité d’une action ou d’une pratique. Il est plus complexe car il affirme que dès lors qu’une firme prend des engagements publics, (a) elle fixe elle-même les critères de jugement de ses propres conduites, (b) elle accepte que ces critères puissent lui être opposables, et (c) elle suppose qu’elle peut elle-même respecter ces critères. Il en résulte que si une firme n’a pas respecté ses engagements, alors elle a agi, pour reprendre l’expression de Cooper, « en-dessous de la norme » (below standards). À la fin de son article, Cooper décrit ce que cet argument signifie : « Si quelqu’un est blâmé pour une chose qui se trouve « en-dessous de la norme », alors cela signifie que le critère en question [la norme] doit généralement pouvoir être respecté. Si personne, réellement ou virtuellement, ne pouvait respecter ce critère, alors on ne parlerait même pas du fait qu’il soit possible ou non de le respecter. » Dès lors qu’un collectif tel qu’une entreprise prend un engagement public de respecter un ensemble de normes, c’est que, en vertu du point (c), il est possible de les respecter – (c) signifiant, dans un langage familier : « Si je déclare que je le ferai, c’est que je peux le faire ».
Bien sûr, la violation d’une norme peut être le fait d’un petit nombre des membres d’une organisation. Mais dès lors que la norme violée est collective et qu’en raison de (c) elle devait et pouvait être respectée, alors la responsabilité est en quelque sorte « à bon droit » imputable au collectif. On trouvera ce genre d’argument relatif au devoir et au pouvoir dans les propos tenus par Bob Diamond, l’ancien directeur général de Barclays, au début du scandale du Libor : « Je suis déçu parce que nombre de ces comportements ont eu lieu sous ma direction. C’est ma responsabilité de m’assurer que cela ne se reproduise pas ».
Alain Anquetil
(1) D. E. Cooper, « Collective responsibility », Philosophy, 43(165), 1968, p. 258-268.
(2) L. May, « Vicarious agency and corporate responsibility », Philosophical Studies, 43, 1983, p. 69-82.
(3) M. Smiley, « Collective responsibility », The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011 Edition, E. N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/collective-responsibility/>.
(4) R. Boatright, « Ethics and the role of the manager », Journal of Business Ethics, 7(4), 1988, p. 303-312.