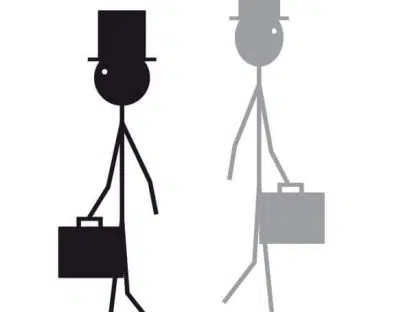Les observations du précédent billet relatif au « travail décent » conduisaient à considérer la décence, telle qu’elle est employée dans cette expression, comme un concept opérationnel dont le sens se limite « à une représentation d’opérations et de comportements particuliers » (1) sans se référer explicitement à sa définition en tant que vertu. Dans le présent article, nous nous intéressons à la décence considérée comme vertu. Deux conceptions sont envisagées : l’une relie la décence à la dignité, la vertu correspondante étant comprise comme la disposition à reconnaître la dignité chez autrui ; l’autre rattache la décence à la morale sociale, soulignant sa contribution à la construction de l’identité personnelle.
1.
Décence et dignité
Pour aborder la première conception de la décence comme vertu, il est judicieux, pour une raison qui apparaîtra dans un instant, de commencer par le contraire de la décence. Ses antonymes font souvent référence à ce qui s’oppose à la bienséance et aux convenances, notamment en matière de mœurs. La liste proposée par le site du CRISCO, de l’Université de Caen Normandie, fait référence à cette signification : cynisme, débauche, déshonnêteté, désordre, effronterie, hardiesse, immodestie, impudeur, impudicité, incongruité, inconvenance, incorrection, indécence, indiscrétion, licence, malhonnêteté, obscénité. À l’évidence, beaucoup de ces mots ne correspondent pas au contraire de la « décence » qui est dénotée dans l’expression « travail décent ».
L’ouvrage La société décente du philosophe Avishaï Margalit propose un antonyme adéquat. Margalit affirme qu’une société décente est « une société dont les institutions n’humilient pas les gens » (2). L’humiliation serait donc l’un des contraires de la décence. On remarque que, définie comme le fait de « faire apparaître quelqu’un (dans tel ou tel de ses aspects) comme inférieur, méprisable, par des paroles ou des actes qui sont interprétés comme abaissant sa dignité », selon la définition du CNRTL, l’humiliation rapproche la décence de la dignité.
C’est précisément la perspective retenue par Carole Gueville dans un article en ligne sur le travail décent tel que le conçoit l’OIT (3). Faisant référence à la « décence ordinaire » (common decency, voir note 2), elle y défendait en effet l’idée que la décence serait une manifestation de la dignité dans une société et un cadre culturel donné.
2.
Dignité et observantia
Comment passer de la valeur de décence – dignité à la vertu ? On trouve une réponse dans un article du philosophe David Albert Jones proposant une approche de la dignité, spécialement appliquée au contexte du soin, fondée sur l’éthique de la vertu (4).
Voici son argument.
Jones note d’abord que reconnaître la dignité d’autrui – ce qui est équivalent, sur le plan de la forme, au fait de lui montrer du respect – suppose certains types de conduite.
Or, ces types de conduite sont le résultat de l’exercice d’une vertu. Suivant Thomas d’Aquin, Jones la désigne comme l’observantia (qui signifie notamment la considération, les égards, la déférence, selon le dictionnaire français-latin Gaffiot). Il s’agit selon lui de « cette vertu par laquelle nous reconnaissons la dignité d’autrui ».
Jones ajoute que l’observantia est liée à la justice, à l’idée de donner à chacun selon son dû. Il affirme en effet que cette vertu « considère de façon appropriée le statut ou la dignité de la personne et par là-même lui témoigne le respect auquel celle-ci a droit ». Il ajoute que cette disposition du caractère comprend deux composantes, l’une consistant à montrer du respect, l’autre à obéir à une autorité.
On peut ici objecter que cette description de la supposée vertu d’observantia revient à postuler l’existence d’une qualité de caractère ad hoc qui serait appropriée à un type de situation, selon une forme d’argument consistant à inférer l’existence d’une vertu d’un type de situation.
De fait, Jones répète plusieurs fois le lien entre une situation et la vertu d’observantia, sans lui donner beaucoup de spécification. Il précise certes que « l’observantia est la vertu qui nous incline à reconnaître le statut particulier ou la dignité d’une personne et », ajoute-t-il, « dans ce cadre, la vertu de respect (dulia) nous dispose spécifiquement à manifester par des signes ou des témoignages l’estime ou l’honneur qui lui sont dues ». Mais une telle affirmation est une nouvelle description plutôt qu’une spécification
Ce manque de spécification vient peut-être du fait que, pour Jones, la vertu d’observantia a une portée générale, c’est-à-dire appropriée à toute situation. En effet, souligne-t-il, « dans la mesure où chacun possède une certaine dignité du fait de son humanité, il en résulte que chacun a droit à un certain niveau de respect ». Et on peut accorder à Jones que reconnaître ce droit suppose un certain état du caractère.
3.
Décence et morale sociale
Un autre angle a été proposé par le professeur de littérature anglaise Richard Freadman (4). Le sens de la décence comme vertu est sans rapport direct avec l’idée de dignité.
Freadman remarque que, dans le contexte de la langue anglaise, le sens du mot « décence » s’est enrichi avec l’usage. Il a d’abord signifié, conformément à son étymologie (le mot vient de decere : convenir), qu’une chose est socialement appropriée ou en accord avec le bon goût. S’est ajouté au début du 20ème siècle un nouveau sens résultant de l’association du mot avec « des qualités morales telles que la gentillesse, la sollicitude et l’amabilité ».
Pour qualifier la relation entre la personne et les convenances, dont la décence est un élément, Freadman se réfère aux distinctions qu’à proposées le philosophe John Kekes (6). Celui-ci observait que la décence « inclut la civilité, la politesse, la bonne volonté, la serviabilité, le fait d’accorder à autrui le bénéfice du doute. […] Elle ne suppose aucune intimité avec autrui ; elle s’applique en fait à des liens humains éphémères ou à des étrangers qui n’ont rien d’autre en commun que la reconnaissance mutuelle qu’ils partagent la même moralité ». Kekes ajoute que « la décence est un ingrédient essentiel de la vie bonne (good lives) car elle favorise plus ou moins l’existence de relations harmonieuses avec d’autres membres de la société ».
Freadman reprend à son compte la distinction que propose Kekes entre deux types de décence : celle qui consiste à se conformer aux règles de la morale sociale (rule-following) et celle qui façonne l’identité (identity-conferring).
La seconde est une conception plus substantielle de la décence car elle lui accorde certaines au moins des propriétés d’une vertu. Elle signifie que la personne qui exerce cette vertu est motivée pour se conformer à la morale sociale, qu’elle approuve ses injonctions et ses interdictions, et plus encore qu’elle évalue les situations et gouverne sa conduite en fonction de ses injonctions et de ses interdictions.
Bref, selon Kekes (toujours cité par Freadman), « cette décence est d’un genre profond ; elle est connectée à ce que nous sommes et à ce que nous voulons être ».
Et, point essentiel pour notre propos, Freadman conclut en affirmant que « ce genre de décence implique une disposition à approuver à première vue ce qui émane de la ‘morale sociale’ ».
4.
Conclusion
On comprend que les perspectives de Jones et Friedman ne sont pas antagonistes. La première est cependant dans un rapport plus direct avec le concept de « travail décent ». Elle a en effet un fond universaliste dans la mesure où elle considère la vertu associée à la dignité (l’observantia) comme une vertu générale.
Mais la seconde, celle de Freadman, est instructive. Freadman observe que les êtres humains cultivent un sens de la décence dans un contexte social, ce qui autorise un certain degré de relativisme. Cependant, il précise qu’il nous incombe d’évaluer les normes de la morale sociale avant d’y adhérer et de les intégrer en quelque sorte à notre identité. Si ces normes violent d’une façon ou d’une autre le sens de la dignité auquel Jones fait référence, alors la morale personnelle, qui comprend la possession et l’exercice de vertus, peut diverger de la morale sociale (7).
Une telle divergence ne peut toutefois pas dépasser un certain point. C’est bien là, semble-t-il, l’impératif vertueux porté par le « travail décent » : cultiver un sens personnel de la dignité qui puisse influencer la morale sociale si nécessaire. Or, cet « état de nécessité » existe bel et bien aujourd’hui.
Alain Anquetil
(1) J’emprunte l’expression à Herbert Marcuse, L’homme unidimensionnel. Études sur l’idéologie de la société industrielle, tr. M. Wittig et H. Marcuse, Paris, Editions de Minuit, 1968.
(2) A. Margalit, The decent society, Harvard University Press, 1998, tr. F. Billard et L. d’Azay, Paris, La société décente, Flammarion, 2007. Margalit s’inspire de la « société décente » de George Orwell et de son idée de « décence commune » (common decency, également traduit par « décence ordinaire » parmi les traductions proposées) présente notamment dans The Road to Wigan Pie. Voir le billet de Philippe Sollers, « Orwell et la ‘common decency’ » , ce billet de blog et la revue de Tristan Storme dans Politique et Sociétés, 282, 2009, p. 190-193. Voir aussi l’ouvrage de Bruce Bégout, De la décence ordinaire. Court essai sur une idée fondamentale de la politique de George Orwell, Paris, Allia, 2008.
(3) C. Gueville, « Le travail décent : analyse conceptuelle », 2013.
(4) D. A. Jones, « Human dignity in healthcare: A virtue ethics approach », The New Bioethics, 21(1), 2015, p. 87-97.
(5) R. Freadman, « Decency and its discontents », Philosophy and Literature, 28(2), 2004, p. 393-405.
(6) J. Kekes, Moral tradition and individuality, Princeton University Press, 1989.
(7) Ce que Kekes et Freadman reconnaissent explicitement.
[cite]